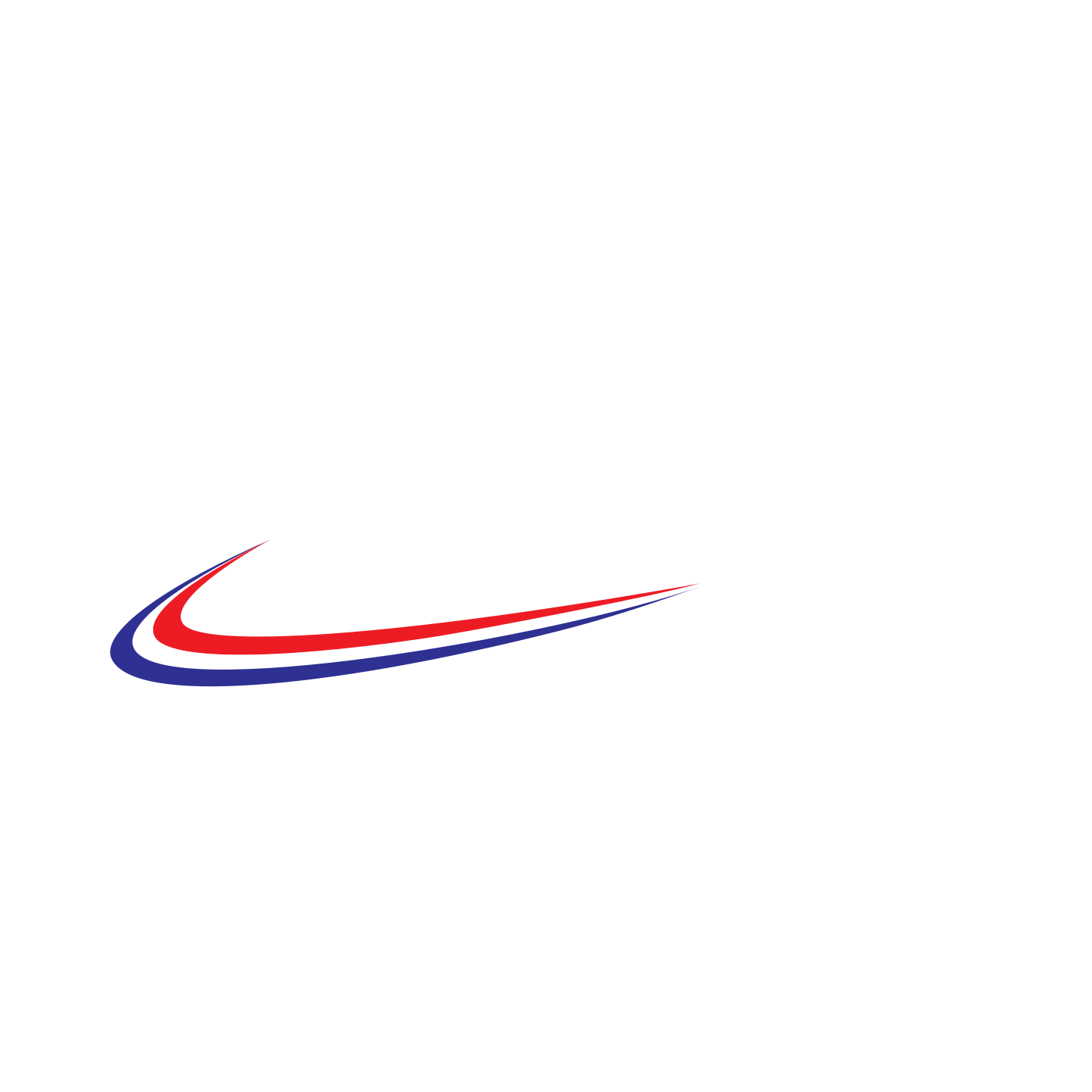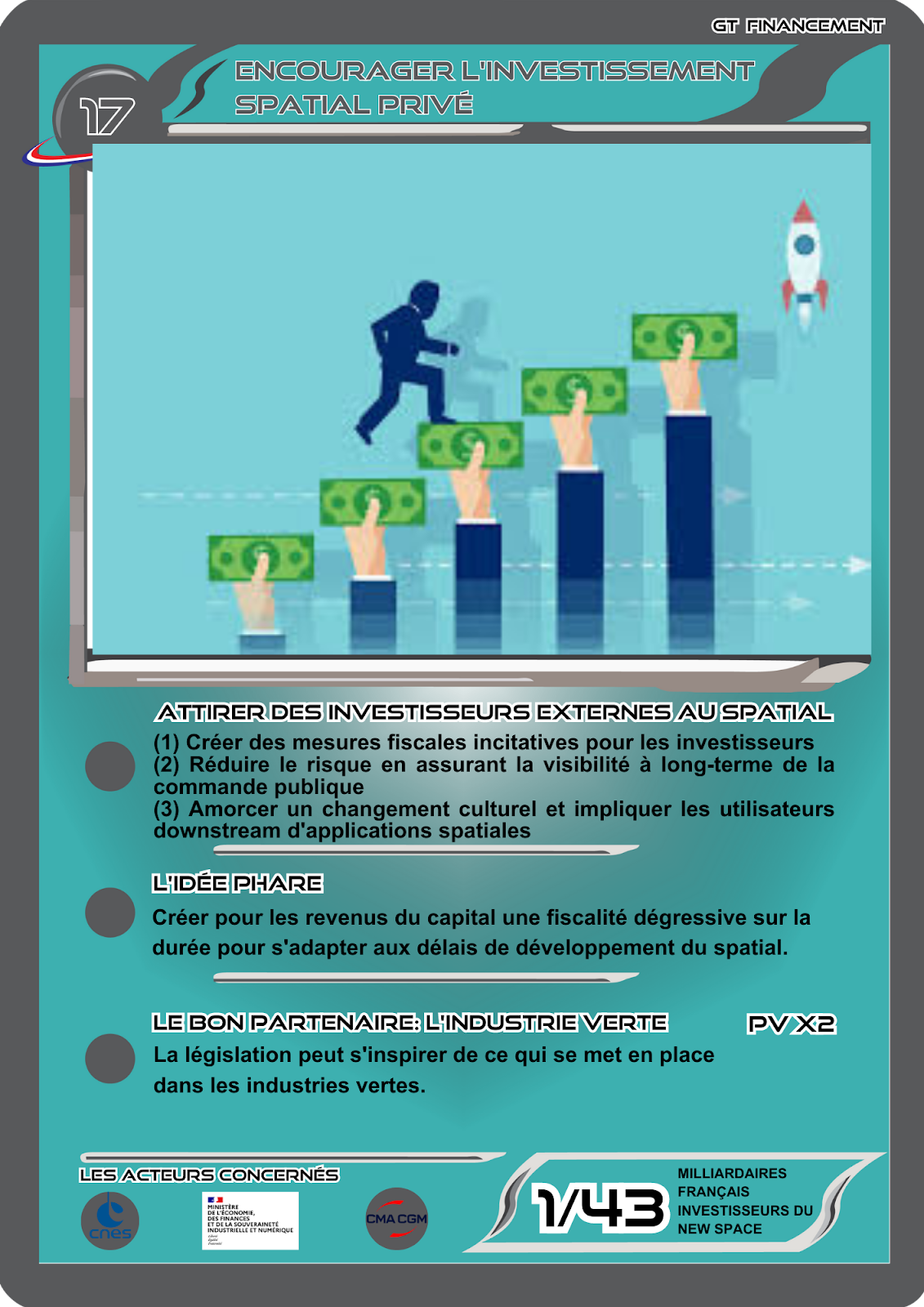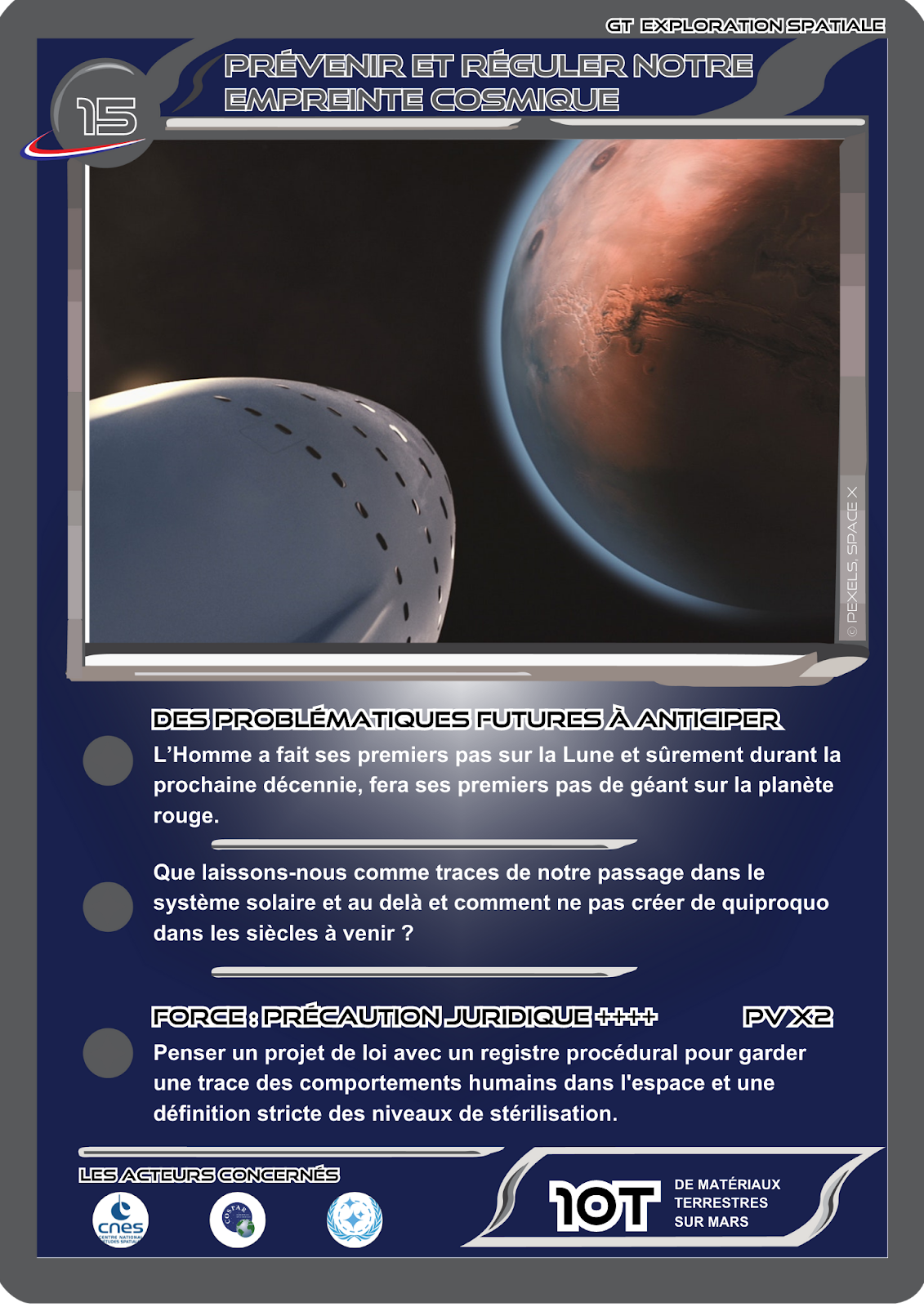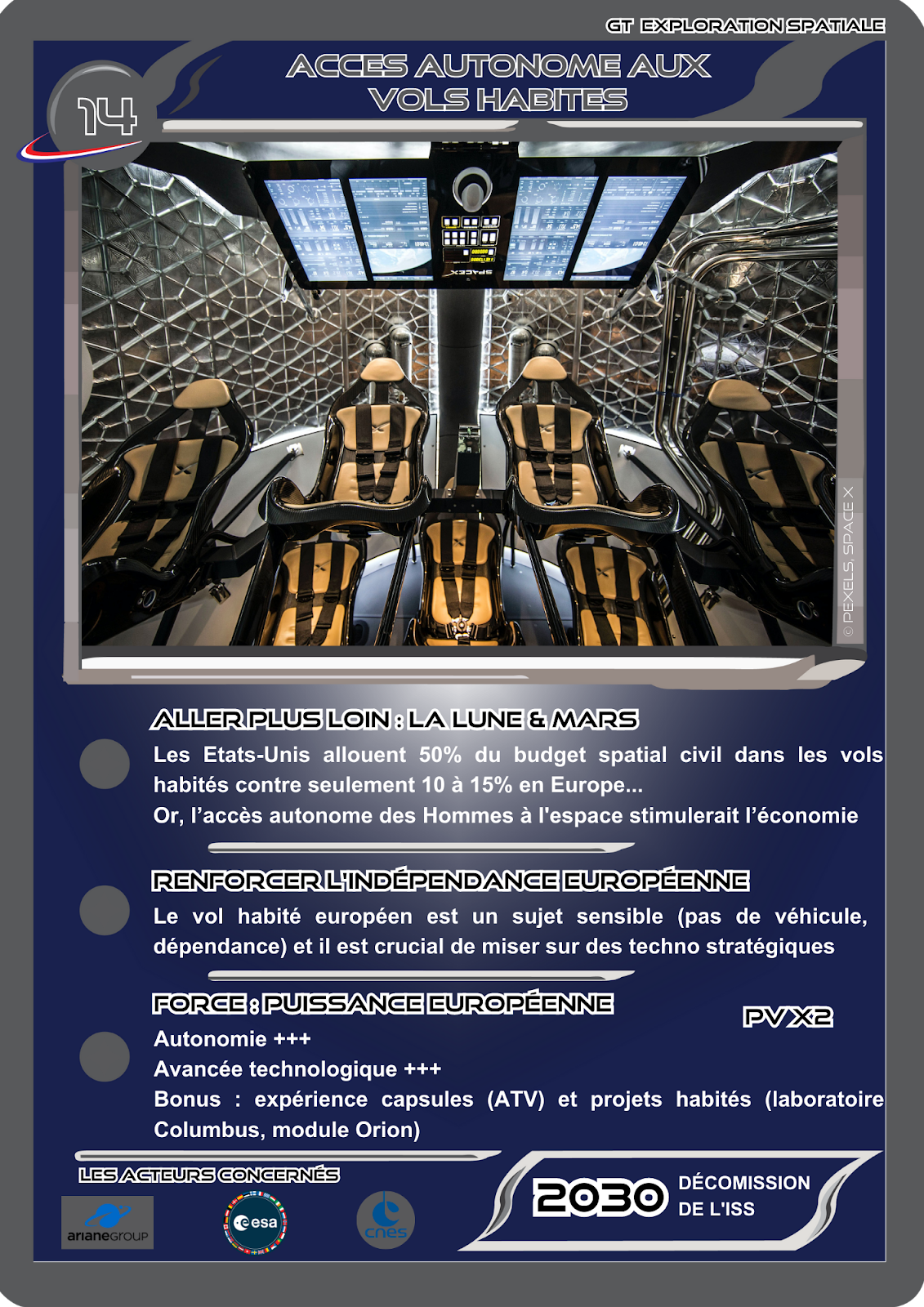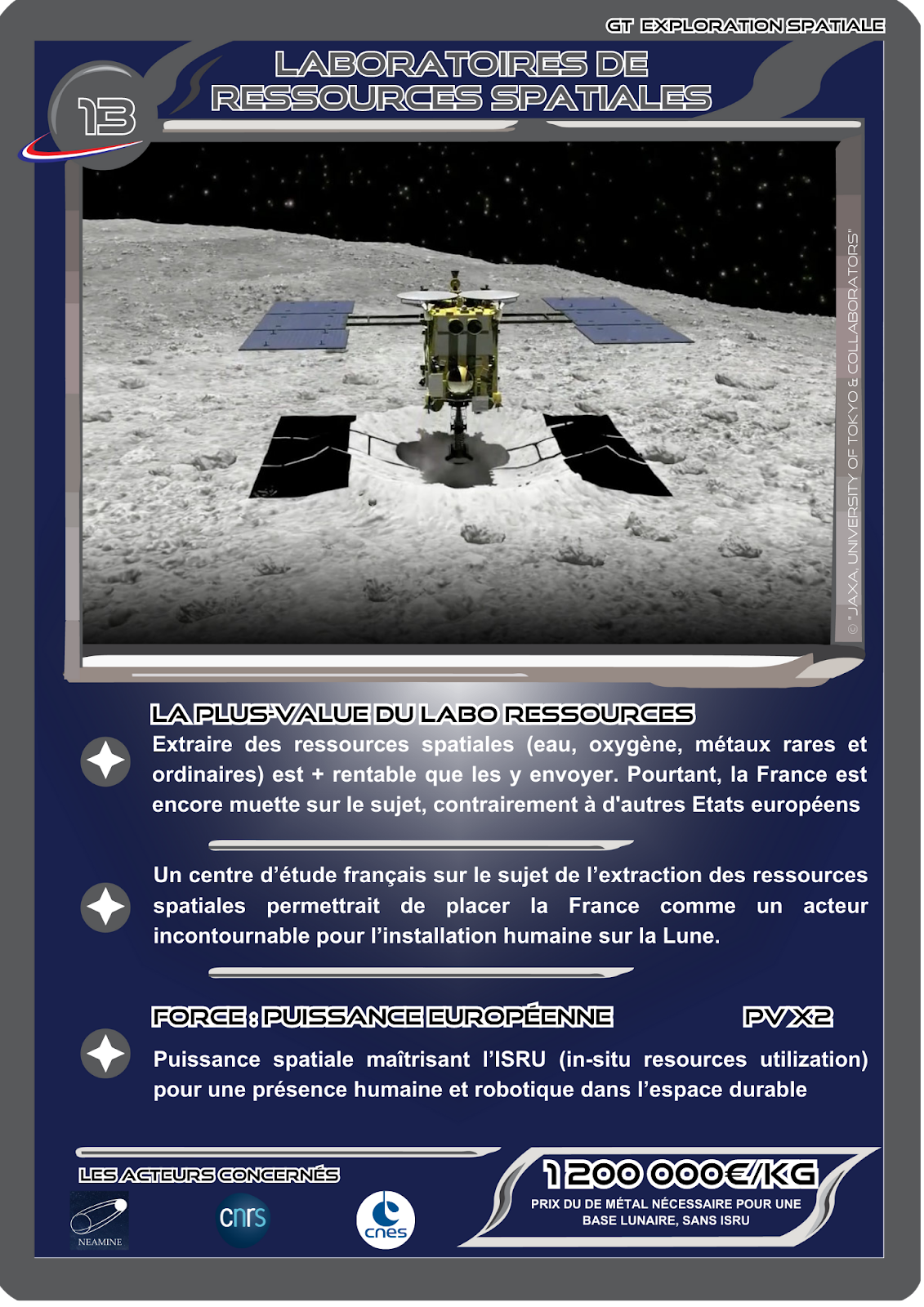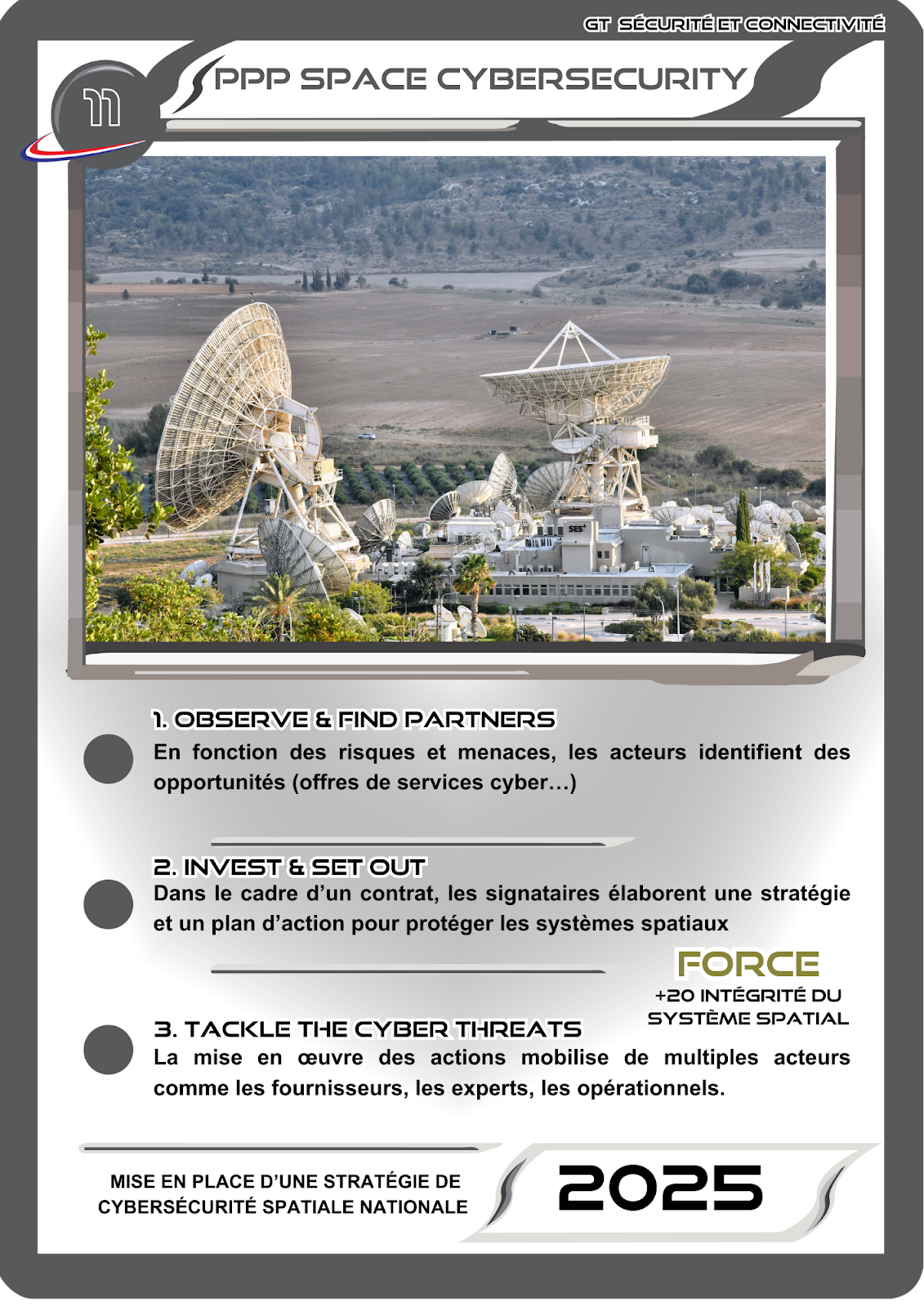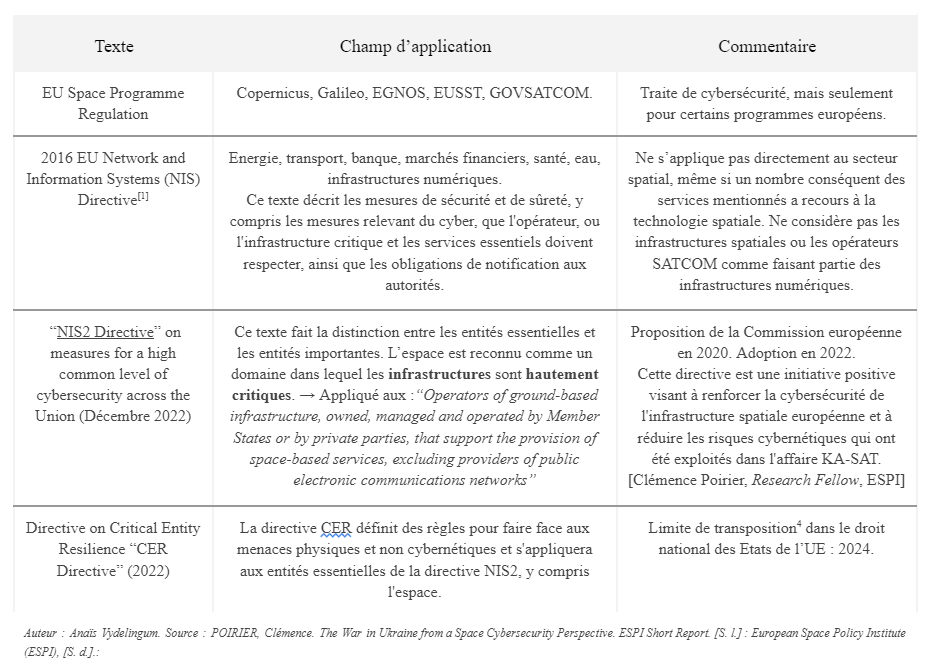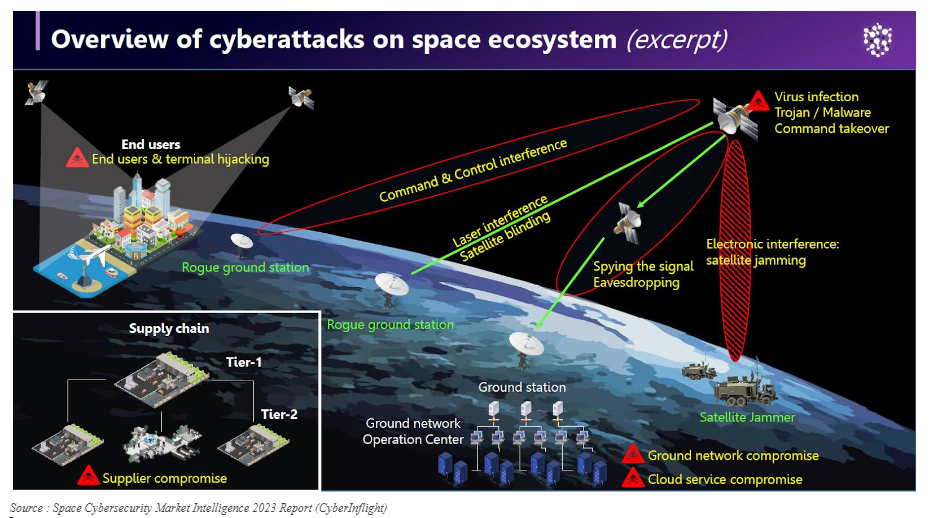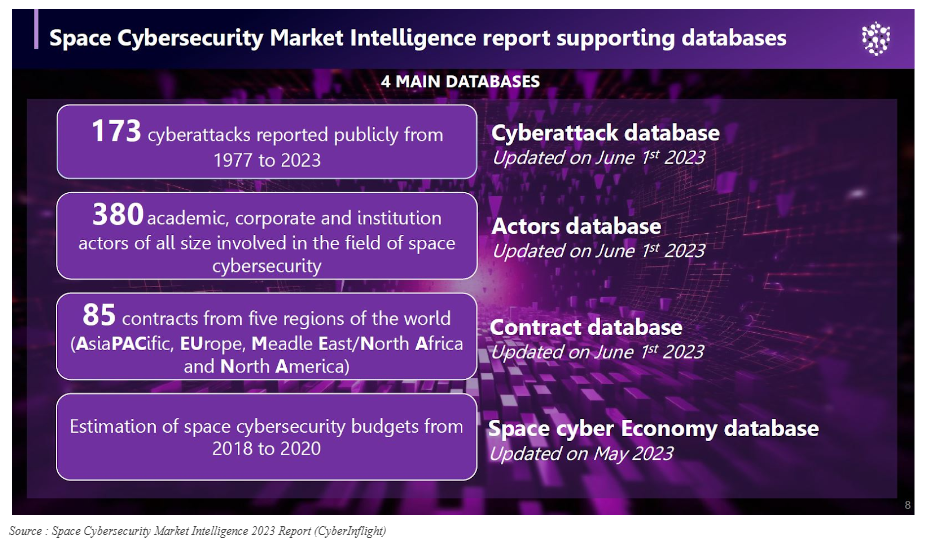Pierre Letellier, Antoine Chesne, Juin 2023
Elon Musk, Jeff Bezos. Ces deux noms résonnent aujourd’hui comme les symboles du New Space américain. Pourtant, les deux plus grandes fortunes d’Amériques ne sont pas nées dans l’industrie spatiale. Ayant fait originellement fait fortune dans les services au e-commerce (PayPal pour Musk, Amazon pour Bezos), c’est à la fois par vision et opportunité qu’ils se sont emparés du secteur spatial et l’ont dynamisé. Une telle success story serait-elle possible en France ? Nous ne manquons pas de milliardaires rivalisant, mais leur intérêt pour l’innovation et la technologie demeure faible. Alors, comment inciter les investisseurs privés, particuliers et fonds, à faire affluer leurs capitaux dans le spatial ?
Créer des mesures incitatives fiscales
L’outil fiscal doit être utilisé pour diriger les capitaux privés vers les technologies et les innovations présentant un fort intérêt stratégique et de souveraineté. L’Espace, par ses différentes composantes (imagerie, télécommunications, IoT, exploration, transport & logistique, fabrication en orbite…) pourrait en bénéficier.
La recommandation
Les autorités fiscales sont à mobiliser pour abaisser le taux effectif d’imposition. Nous suggérons :
- De bâtir une fiscalité dégressive du capital investi selon la durée du projet industriel pour s’adapter aux conditions de développement du spatial.
- de faciliter la mise en place de fonds de placements permettant de répartir le risque des capitaux investis dans un “pool” d’acteurs émergents.
Le secteur spatial pourrait prendre pour modèle la finance verte et ses méthodes pour flécher les investissements vers les technologies et les industries de la transition énergétique. En particulier on soulignera le rôle des placements pour particulier (comme le Livret de Développement Durable, 142.2 Md€ déposés au 31 mai 2023) ou les obligations vertes dont bénéficient les entreprises. Il serait possible de les transposer en faveur d’autres secteurs stratégiques comme le spatial.
Limites / points d’attention
Le problème de cette stratégie, selon l’OCDE (2015), la réduction de la charge fiscale a peu d’effet sur l’investissement car l’incitation fiscale ne remédie pas les défaillances directement, ne demande pas de sortie de fonds pour des subventions etc. Quand bien même dans une industrie spatiale internationale le pays au taux le plus faible pourrait être avantagé, cela risque de créer un phénomène de surenchère dont tout le pays pâtirait. Il faut alors poser la question de l’évaluation des coûts et avantages de cette politique d’incitation ; ainsi qu’une mise à l’échelle européenne de cette approche pour éviter la compétition. L’UE investit d’ores et déjà dans le succès des startups par le biais de la commande publique (10-30% de d’IRIS² doit être à destination de contractants startups ou de moyennes entreprises du spatial). L’approche par la taxation est donc à moduler avec les autres approches présentées dans cette note de réflexion.
Chiffre clé : “10 percentage point increase in the corporate income tax rate lowering FDI by 0.45 percentage point of GDP”
Assurer la visibilité par la commande publique
La “vallée de la mort” désigne dans le capital-risque la période de danger pour les startups entre les levées de fonds et la rentabilité. Dans le secteur spatial, cette vallée est particulièrement large, ce qui freine les investisseurs craignant le manque d’assurance sur les revenus à long-terme.
La recommandation
- Nous proposons de repenser les mécanismes de commande publique pour assurer davantage de visibilité sur les revenus pour les acteurs du New Space. Plutôt que de multiplier les contrats public-privés, avec des budgets alloués annuellement, nous proposons une programmation plus longue et des contrats cadres fléchant les revenus à horizon 5 à 10 ans.
Une idée serait également de faire signer une charte d’engagement sur la durée des contrats de commande publique. En échange de contrats sur le plus long-terme, les institutions (ex : CNES) peuvent demander la possibilité d’un droit de regard plus extensif sur la direction du projet, et notamment invoquer un droit de retrait à mi-parcours en cas d’échec industriel. La mesure ne doit pas remettre en cause les principes de concurrence et les avantages qui en sont tirés par l’Etat. De façon cohérente, pour soutenir le tissu du news pace et ses investisseurs, ces grandes commandes sur le long terme doivent leur être en partie adressées. A l’image de la constellation IRIS² : 30% des contrats doivent être attribués à des PME, afin d’éviter la monopolisation des ressources par les géants satellitaires (Airbus, TAS, OHB), des lanceurs (ArianeGroup) et des télécom (EutelSat, SES, Hispasat…).
Limites / points d’attention
Ce type de contrat de long-terme existe déjà au sein de l’ESA, mais dans le New Space européen il a été mis en oeuvre dans des pays dont les géants du secteurs n’accaparent pas l’essentiel des commandes publiques. On citera en Suisse Clearspace, championne des retraits de débris orbitaux, qui bénéficient d’un contrat en trois étapes avec l’ESA. Clearspace bénéficie en grande partie du retour géographique des montants investis par la Suisse au sein de l’ESA. L’essentiel des montants investis par la France dans l’ESA allant à nos filières lanceurs et satellites lourds, il faut veiller à un équilibre entre grands groupes et PME pour assurer que les innovations de rupture puissent émerger et s’industrialiser grâce aux contrats cadres et la commande publique.
Impliquer les clients finaux du spatial
Notre goût du risque n’est peut-être pas le même en Europe qu’outre-Atlantique ; un effort culturel est à construire dans le domaine financier pour que les investisseurs non-initiés alimentent le secteur.
“In the U.S., the risk appetite is far greater. Investors are often open to entrepreneurs whose early venture has failed because they are seen as better for the first-hand experience. It’s okay to fail and try again, and so it’s okay to lose money at times.” “”Aux États-Unis, le goût du risque est beaucoup plus grand. Les investisseurs sont souvent ouverts aux entrepreneurs dont la première entreprise a échoué, parce qu’ils sont considérés comme plus compétents du fait de leur expérience directe. Il n’y a pas de mal à échouer et à réessayer, et il n’y a donc pas de mal à perdre de l’argent de temps en temps.”
La recommandation
Développer des programmes d’éducation des investisseurs et des mécanismes de soutien pour éduquer les entreprises de l’industrie non spatiale sur le secteur, ses rendements potentiels et les stratégies d’atténuation des risques.
Cela inclurait des workshops, des programmes de mentorat et des ressources en ligne pour accroître la confiance et les connaissances des investisseurs.
D’accroître la relation entre clients finaux des applications spatiales et le secteur amont spatial en encourageant les partenariats stratégiques entre New Space et partenaires à la fois investisseurs et clients.
Pour cela, on ne peut qu’encourager les acteurs du New Space et leurs leveurs de fonds à adapter leur stratégie de recherche de financements aux clients finaux non-spatiaux. Il faut aller chercher les investisseurs là où se situe la création de valeur du spatial : parmi les clients des applications, et les associer plus en amont aux développement de l’infrastructure capable de produire les données qu’eux même utilisent.
Limites / points d’attention
Ces mesures sont utiles pour essaimer l’information et créer des passerelles, mais ne suffisent pas compte-tenu des différences de cultures (compréhension de la technologie, rapport au risque…) entre le New Space et les clients finaux non-spatiaux. L’émergence de licornes et d’applications à succès seraient les meilleurs moyens pour convaincre les clients finaux d’investir dans le spatial.
Sources
- OCDE (2015), “Cadre d’action pour l’investissement”, édition 2015, Éditions OCDE, Paris,
- https://doi.org/10.1787/9789264235441-fr.
- Klemm and Van Parys, 2009, “Empirical Evidence on the Effect of Tax Incentives,” IMF Working Paper 09/136
- Rami Cassis, 2022, “Cultural Differences Explain The Business Chasm Between The U.S. And Europe”, Small Business, Forbes, https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2022/04/13/cultural-differences-explain-the-business-chasm-between-the-us-and-europe/?sh=58cc88e72775