Par le GT International
Résumé
Depuis Spoutnik en 1957, l’espace est devenu un enjeu stratégique mondial, passant de terrain d’innovation technologique à théâtre potentiel de conflits. Face à la militarisation croissante et aux nouvelles menaces spatiales, la France renforce ses capacités grâce à des investissements majeurs, la création d’un Commandement de l’espace, et une coopération internationale accrue. Elle anticipe les défis futurs, notamment la prolifération des armes antisatellites, la congestion orbitale et les zones grises du droit spatial.
Contexte historique
L’espace a commencé à devenir un environnement considéré comme stratégique depuis le lancement du satellite Spoutnik en 1957, en particulier pour les grandes puissances mondiales de la dynamique bipolaire de cette époque : Les États-Unis et l’Union soviétique1. Pendant toute la durée de la guerre froide, ces deux acteurs majeurs ont poursuivi le développement de programmes spatiaux à utilité militaire, notamment en matière de satellites de reconnaissance et de communication2. D’un point de vue global, la perception de l’espace sur la scène internationale restait cependant essentiellement ancrée comme un domaine de compétition lié à l’innovation technologique et non comme un théâtre de conflit direct à proprement parler3. D’ailleurs, cette vision se reflète dans la signature du Traité de l’espace en 1967 qui, de façon explicite, proscrit la présence d’armes nucléaires et autres armes de destruction massive dans l’espace4.

Toutefois, le développement proactif de technologies sophistiquées et innovantes au potentiel déstabilisateur voire destructeur pour les diverses parties étatiques, ainsi que l’introduction toujours croissante des acteurs privés dans ce secteur marquent un basculement5. De cette façon, la vision commune de l’espace extra-atmosphérique bascule d’un environnement purement stratégique, à un terrain d’opérations militaires tant offensives que défensives6.
Actualités et pertinence pour la France
L’amplification de la militarisation de l’espace s’observe de façon claire ces dernières années. Cela s’observe par plusieurs événements, notamment des démonstrations de force, même si les raisons invoquées diffèrent. Par exemple, en dépit de la production de débris générés, des essais antisatellites cinétiques ont été menés par les acteurs spatiaux majeurs entre le début des années 2000 et aujourd’hui. La Chine a détruit son satellite FengYun 1C en 2007 ; les États-Unis ont fait de même avec leur satellite USA-193 en 2018 ; pareil du côté de l’Inde avec son satellite Microsat-R en 2019 ; et enfin plus récemment, la Russie a détruit son satellite Cosmos 1408 en 20217. En plus de ces incidents, il est important de noter que le développement exponentiel des capacités antisatellites non-cinétiques par les grandes puissances, ainsi que l’utilisation faite de ces technologies, démontrent tout autant la progression de l’environnement spatial comme un théâtre conflictuel – comme analysés dans le rapport annuel de la Secure World Foundation « Global Counterspace Capabilities »8.
Face à cette évolution des dynamiques dans les stratégies adoptées par les puissances spatiales, ainsi que les menaces y afférentes, la France a opté pour une position proactive, consolidant ses capacités à la fois sur le plan stratégique et sur le plan opérationnel. Dans cette optique, le ministère des Armées s’est révélé ambitieux, en exposant une intention d’allocation d’investissement 700 millions d’euros supplémentaires pour la stratégie spatiale pour la période 2019-2025, en plus des 3,6 milliards d’euros déjà octroyés dans la Loi de programmation militaire pour cette même période9. Toujours dans cette même vision, juillet 2019, le projet Ares démontre l’engagement de la France dans le renforcement de ses capacités, particulièrement en matière de surveillance, d’identification des menaces et d’intervention dans la protection de satellites nationaux10. Le premier septembre 2019, la création du Commandement de l’espace a également été un reflet important de cette stratégie11. Par la mise en place de cet organisme à vocation interarmées de l’Armée de l’air et de l’Espace, la France appuie adroitement la coordination de ses moyens dans le cadre de la défense spatiale. Plus tard, le projet TOUTATIS complémentant le projet YODA, annonce par la direction générale de l’armement en septembre 2024 reflète également une volonté de la France de renforcer sa stratégie de défense, dans ce contexte, en orbite basse12. Un mois après, l’adhésion de la France à l’Opération Olympic Defender, chapeautée par les États-Unis, démontre une volonté de la France de renforcer ses capacités opérationnelles grâce à une plus grande coopération internationale13. Ces différentes initiatives et démarches de la France dans sa stratégie et ses opérations démontrent une résilience forte face à un environnement spatial toujours plus instable sur le plan sécuritaire.
Enjeux futurs
À l’avenir, de nombreux défis surgiront et la France devra se tenir prête pour y faire face. Les démonstrations de force des acteurs spatiaux majeurs ainsi que le développement exponentiel de leurs capacités, en particulier ceux à caractère non-cinétique tels que les dispositifs antisatellites de types cybernétiques, guerre électronique et armes à énergies dirigées représentent les menaces les plus réelles dans le cadre des conflits spatiaux de demain14. De plus, les zones grises et délimitations troubles dans le domaine du droit spatial, exacerbées par le phénomène de surrogate warefare – illustrés par les contrats privé-public dans le cadre d’atteinte aux objectifs stratégiques, ainsi que l’utilisation des capacités à doubles usages par les forces rivales compliquent davantage la protection des intérêts nationaux15. Enfin la congestion de l’environnement orbitale de la terre, en particulier en l’orbite basse représente un défi connu et de taille pour tout acteur dans le secteur spatial y compris la France16. En réponse à ces menaces, les investissements prévus par la Loi de programmation militaire 2024-2030 prennent en considération le besoin primordial du renforcement des capacités spatiales sur le plan militaire17. Cependant, la France devra combiner ces effets avec la poursuite de sa posture proactive dans la promotion de normes internationales régulatrices des activités spatiales, en particulier dans la prévention des conflits.
- https://www.nasa.gov/image-article/oct-4-1957-sputnik-dawn-of-space-age/ ↩︎
- https://shs.cairn.info/revue-defense-nationale-2016-6-page-99?lang=fr#s2n4 ↩︎
- https://www.jstor.org/stable/42669540?seq=1 p.279. ↩︎
- https://www.unoosa.org/pdf/gares/ARES_21_2222F.pdf ↩︎
- https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/affaires-etrangeres/la-militarisation-de-l-espace-9014350 ; https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/CSSAnalyse333-FR.pdf ↩︎
- https://www.defense.gouv.fr/comment-france-se-prepare-conflit-spatial/lespace-nouveau-theatre-conflictualite ↩︎
- https://swfound.org/media/207826/swf_global_counterspace_capabilities_2024.pdf ↩︎
- https://swfound.org/media/207826/swf_global_counterspace_capabilities_2024.pdf pp. [03-12], [01-16], [04-04], and [05-01]. ↩︎
- https://www.archives.defense.gouv.fr/portail/actualites2/florence-parly-devoile-la-strategie-spatiale-francaise-de-defense.html ↩︎
- https://www.defense.gouv.fr/comment-france-se-prepare-conflit-spatial/ares-dga-prepare-notre-maitrise-lespace ↩︎
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039060428/ ↩︎
- https://www.defense.gouv.fr/aid/actualites/spatial-lagence-linnovation-defense-notifie-u-space-realisation-dune-demonstration-dactions-orbite ↩︎
- https://www.defense.gouv.fr/actualites/france-rejoint-force-multinationale-operation-olympic-defender ↩︎
- https://www.icrc.org/fr/droit-et-politique/operations-militaires-dans-espace ↩︎
- https://academic.oup.com/psq/article-abstract/135/2/341/6848549?login=false ↩︎
- https://www.esa.int/Space_Safety/Space_Debris/ESA_Space_Environment_Report_2024 ↩︎
- https://www.defense.gouv.fr/ministere/politique-defense/loi-programmation-militaire-2024-2030 ↩︎

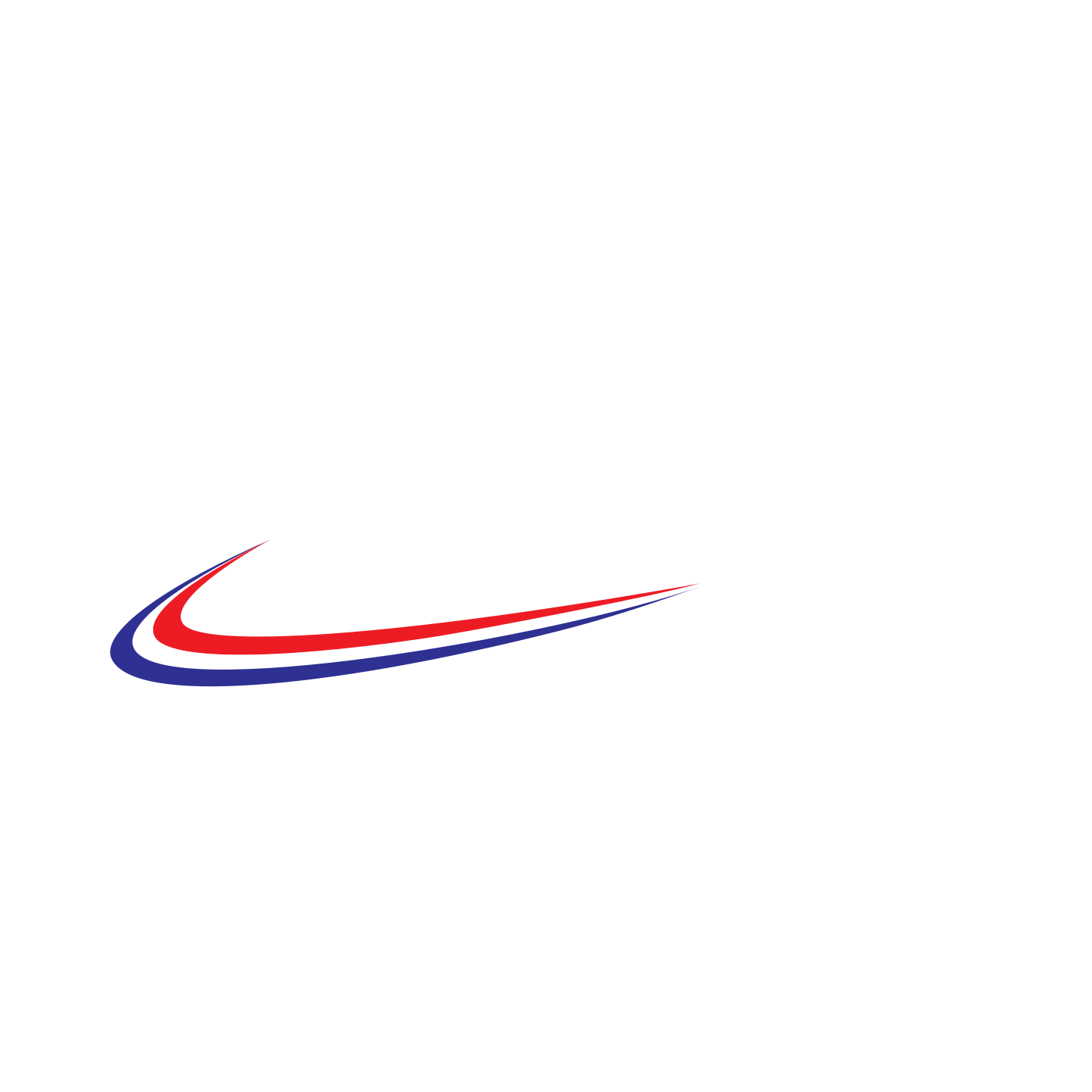

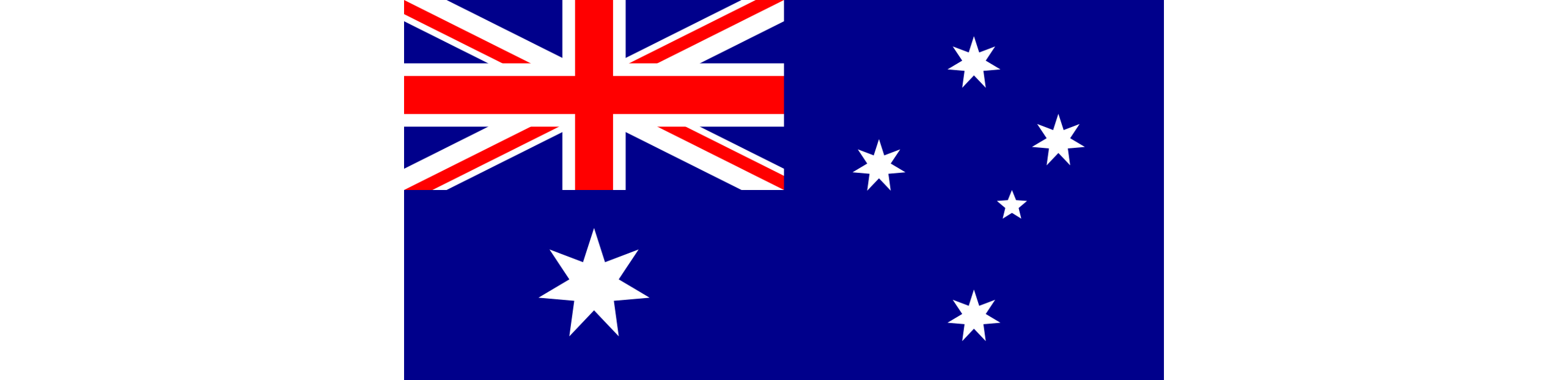

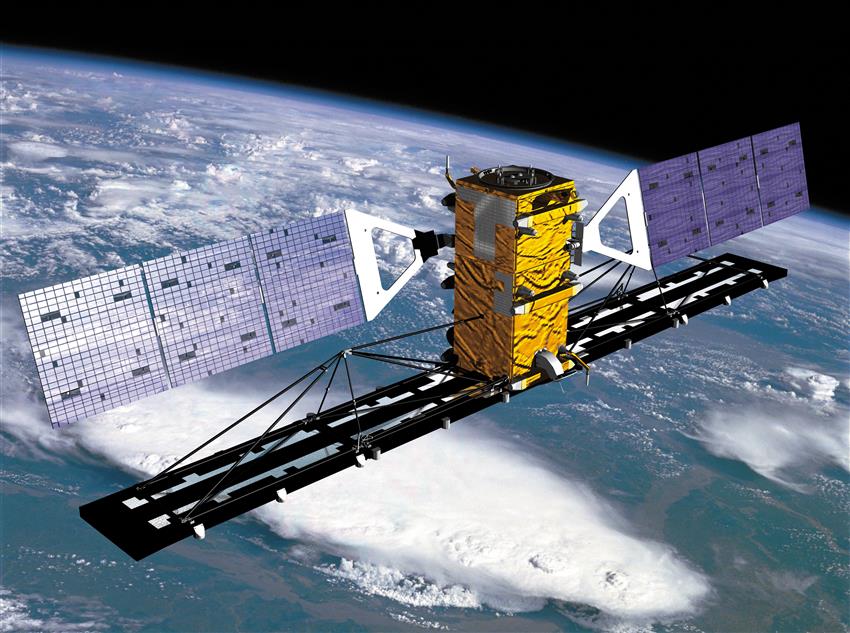




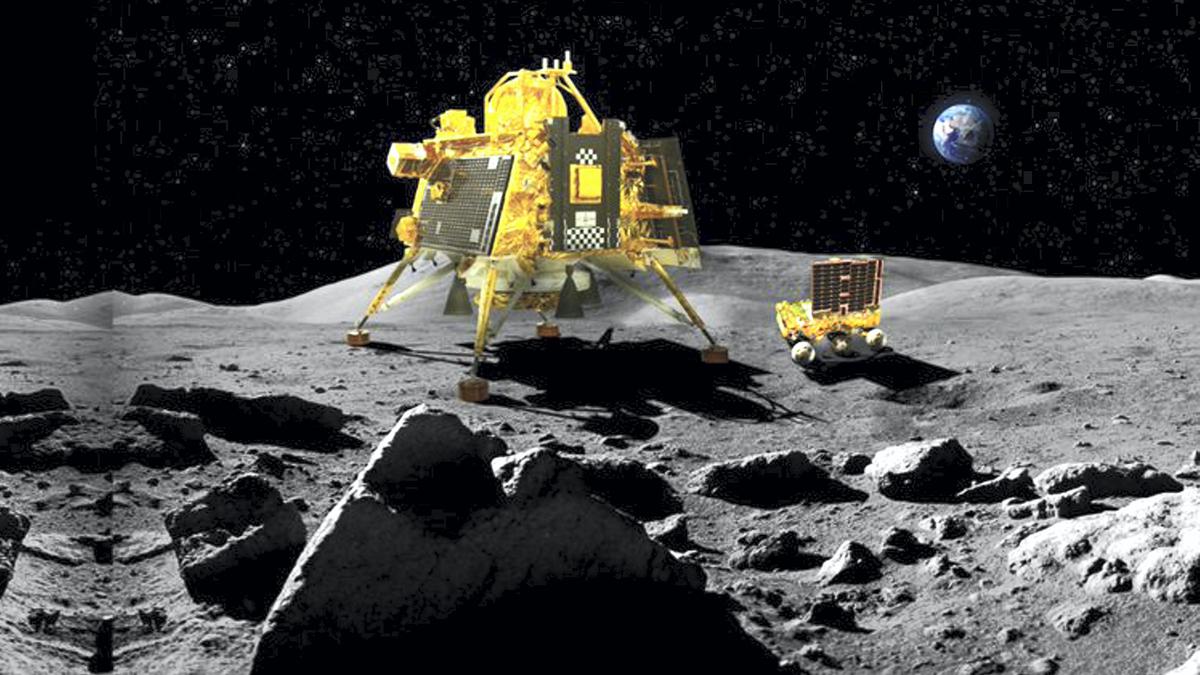
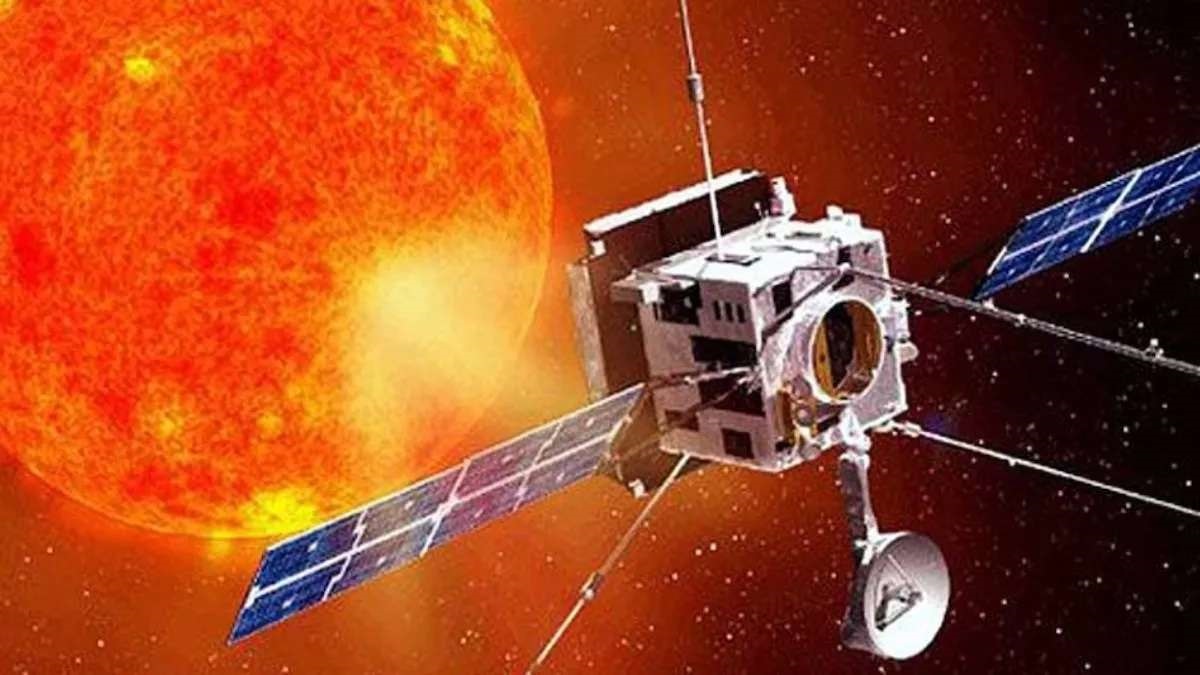

:quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/PPE76ENPVNEDXA2JA4PLMZGTIM.jpg)
