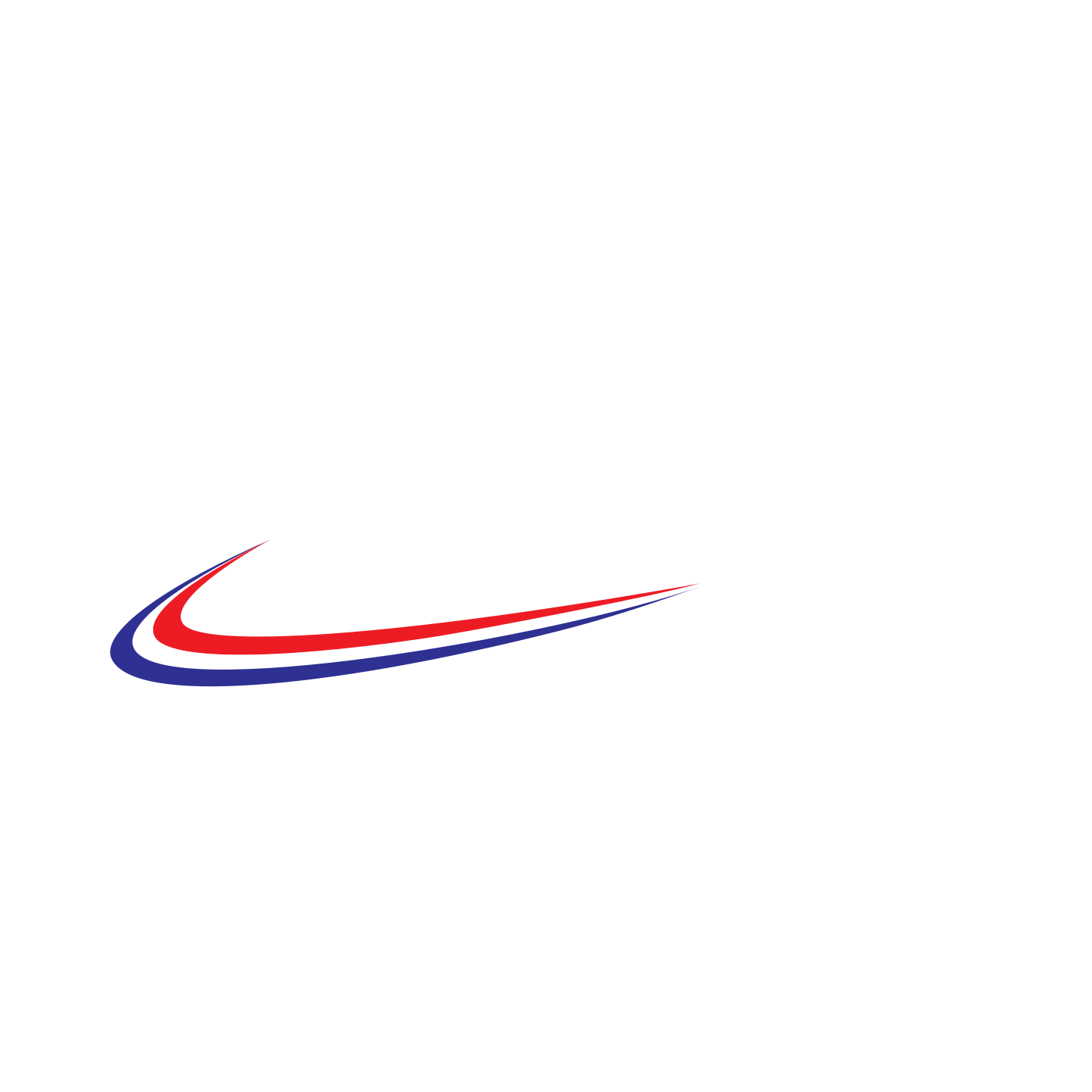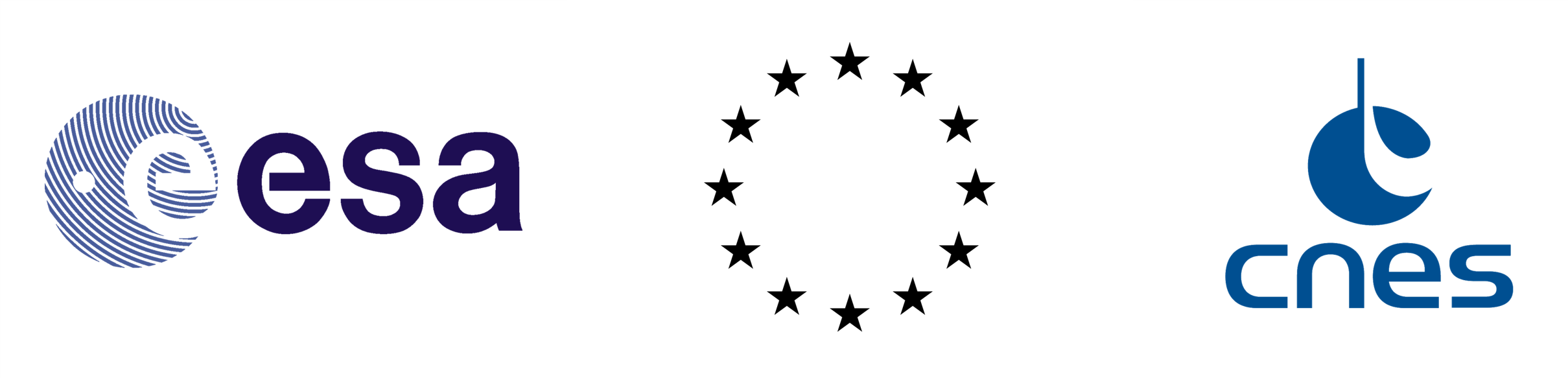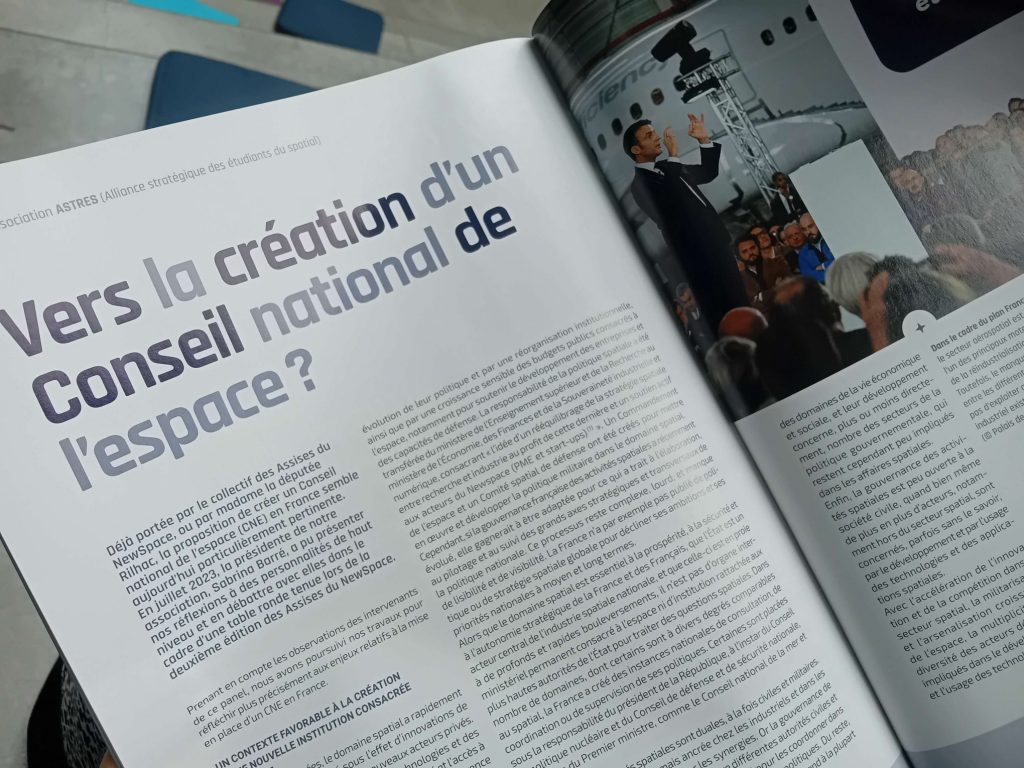Chaque mois, l’équipe Communication vous partage les coulisses de l’association : idées, projets, nouveautés et inspirations ! L’occasion d’en savoir plus sur nous au cours de l’année, et peut-être, nous rejoindre…
PROJETS & IDEES
Conférences de rentrée #CDR
L’équipe s’est concentrée sur la préparation des Conférences De Rentrée : 9 conférences, une par Groupe de Travail, pour initier un large public à la variété des enjeux du spatial, en compagnie du mentor du GT choisi pour l’année. Ces conférences sont l’occasion de mieux connaître les membres de l’association, leurs idées pour l’année à venir et d’apprendre avec le mentor, réputé dans son domaine.
Les CDR ont lieu du 29 septembre au 8 novembre 2025, ouvertes à tous, gratuites et en visioconférence. Les inscriptions sont obligatoires, et disponibles ici.
29 septembre : GT Culture Spatiale, avec Erika Velio
01 octobre : GT Développement durable, avec Quentin Guého
09 octobre : GT Exploration spatiale, avec Jérôme Vila
13 octobre : GT International, avec Nicolas Maubert
20 octobre : GT Lanceurs, avec Arnaud Demay
23 octobre : GT Gouvernance, avec Béatrice Hainaut
date à confirmer: GT Sécurité et connectivité, GT Energie, GT Financement
Participation au dispositif Space’ibles du CNES
L’Europe a-t-elle un récit mobilisateur soutenant son exploration spatiale, au même titre que les Etats-Unis ont développé et imposé dans les représentations collectives l’imaginaire de la frontière et de la conquête ?
C’est la question à laquelle les membres des GT Exploration Spatiale et Culture Spatiale, menés par Auriane Decker, ont cherché à répondre pour contribuer au rapport du groupe ” Europe et Exploration spatiale ” des Space’ibles du CNES. Guettez notre prochaine publication !
Discussions avec l’Institut Français de l’Histoire de l’Espace
De belles idées sont en cours de discussions avec l’IFHE, une association dédiée à l’histoire spatiale française et européenne, sa sauvegarde et sa valorisation. ASTRES étant essentiellement composée d’étudiants aux formations non techniques, il y a de nombreuses opportunités pour travailler ensemble à l’avenir.
Evènements et ateliers
Session Questions/Réponses avec la Chaire Espace de l’Ecole Nationale Supérieure – 02 octobre 2025
Le monde de la recherche peut être obscure et notre partenariat avec l’ENS vise à éclairer ces ténèbres. La Chaire Espace examine les nouveaux enjeux sociaux-culturels, géostratégiques et environnementaux de la relation Terre-Espace.
Le 02 octobre en soirée, venez poser vos questions aux doctorants et enseignants chercheurs de la Chaire Espace, en ligne ou en présentiel. Il reste quelques places ici : Inscriptions
Un tour à la World Satellite Business Week
Alix Guigné (présidente), Charlotte Berthoumieux (responsable évenementiel) et Sabrina Barré (vice-présidente) ont pu participé à la fameuse WSBW, rendez-vous parisien incontournable de la rentrée. Une chance exceptionnelle au coeur du spatial !

Premier afterwork de l’année
Nous avons repris le rendez-vous mensuel aux Ateliers Gaîté, en accueillant déjà une quinzaine de nouveaux adhérents !

LE COIN INSPIRATIONS
Retrouvez les lectures et contenus extérieurs qui ont inspiré nos GT ce mois-ci. Partagez-nous les vôtres en retour !
Témoignage de Claudie Haigneré sur notre stand au Bourget
Podcast “1961, naissance du Centre National d’Etudes Spatiales” sur France Culture
Article “News about Space transportation and Nuclear Propulsion” de l’ESA
Podcast “Space to grow” de Jaime Martín Lozano
LE mois prochain

Nous serons au NextSpace Symposium de Way4Space, à Bordeaux les 9 et 10 octobre. Venez à notre stand récupérer les dernières Astrocartes 2025 !

ASTRES aligne son équipe de champions à la course solidaire AéroRun du 19 Octobre, sur la marche et la course.