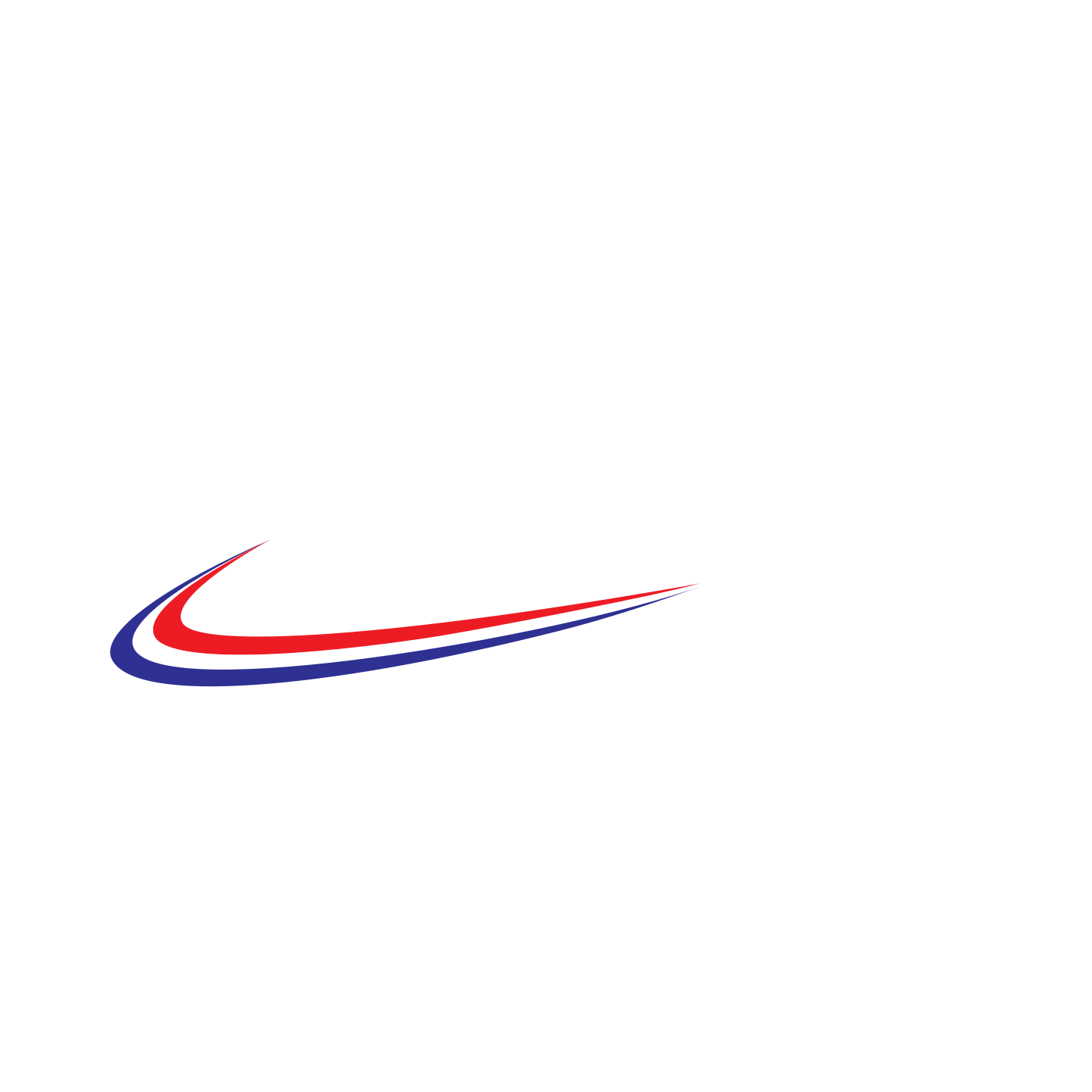La France fait partie des premières nations à s’être intéressées à l’aviation et à l’espace. La tradition aérospatiale française a perduré dans le temps, voyant passer de nombreux scientifiques et ingénieurs qui ont travaillé d’arrache-pied pour lui donner la place qu’elle occupe aujourd’hui dans le panorama mondial de ce secteur. Pour entretenir cet élan, des centres de formation doivent garantir aux nouvelles générations un accès direct au monde du spatial, afin qu’elles sachent vers où orienter leurs efforts durant leurs études. Dans ce document, nous allons faire un tour de table des formations qui donnent accès aux métiers de l’aérospatial, en tentant d’évaluer les performances des établissements et en donnant des pistes pour améliorer l’attractivité de ces formations. Il ne s’agira pas de proposer des changements au cas par cas dans les écoles, mais plutôt de donner une ligne générale à prendre en compte pour aider les jeunes étudiants à entrer par la grande porte dans le monde du spatial, et ainsi façonner l’industrie française de demain.
Les voies d’accès au secteur spatial
Liste des formations spécialisée dans le spatial
S’il existe de nombreuses façons de se faire recruter dans l’industrie spatiale, la “voie royale” reste d’intégrer une formation (Grande École, Université ou formation professionnelle) en lien direct avec cette industrie. Les établissements spécialisés offrent en effet aux étudiants la possibilité de se construire un réseau professionnel pendant les études; discussions avec un professeur, participation à des événements ou contact avec des camarades, c’est en grande partie de cette manière que l’on finit par se faire recruter aujourd’hui.Le site Internet de l’ISSAT1 – Institut au Service du Spatial, de ses Applications et Technologie répertorie chaque année en son sein 174 formations sur le sol français. En collaboration avec le CNES, il aide les jeunes étudiants qui souhaitent s’orienter vers ce milieu à choisir consciencieusement leur cursus scolaire, en fournissant des liens utiles, plaquettes et fiches descriptives que les utilisateurs peuvent suivre2. Parmi ces établissements, on trouve:
- 54 universités publiques;
- 52 Grandes Écoles d’Ingénieur;
- 4 écoles spécialisées en commerce et marketing;
- 24 Instituts Universitaires de Technologie, dont un à Kourou;
- 4 organismes offrant une formation en ligne, dont l’EUSPA – European Union Space Program Agency et l’European Space University for Space and Humanity.
Le classement par région nous révèle que les zones autour de Paris et Toulouse sont les plus “fournies” en termes de formations aérospatiales.
Il existe plusieurs parcours proposés dans des universités de sciences humaines, comme l’UFR “Lettres et sciences humaines” de Rouen: il s’agit dans la quasi-totalité de cours sur l’environnement, la géographie et l’observation de la Terre, qui s’appuient sur les données des satellites artificiels en orbite.
La satisfaction des entreprises
Il existe quelques outils, disponibles en source ouverte, qui peuvent témoigner de l’appréciation globale des entreprises employant des néo-diplômés de la filière spatiale.
Pour la filière scientifique, on trouve le rapport de l’Observatoire des Métiers de l’Air et de l’Espace3, commandé par l’IPSA – Institut Polytechnique des Sciences Avancées et édité périodiquement depuis 2017. Il regroupe en son sein les résultats d’enquêtes anonymes des responsables de plus de 200 entreprises spécialisées dans le secteur aéronautique et aérospatial telles qu’Airbus, Thalès ou Safran. Dans l’édition 2023, la dernière en date, 40% des entreprises estiment que le recrutement d’ingénieurs, de techniciens supérieurs, des opérateurs et des mécaniciens spécialisés va être très important dans les années à venir. De plus, on y apprend que 75% d’entre elles s’estiment satisfaites des élèves ingénieurs embauchés dans tous les domaines proposés; mis à part pour la compétence “Connaissance du monde de l’entreprise”, qui affiche un taux de satisfaction de 67%, tous les paramètres (dont la capacité à s’adapter à l’entreprise et la capacité à s’intégrer dans une équipe) sont considérés satisfaisants à près de 90%, avec un niveau académique jugé “Très satisfaisant” par 33% des entreprises.
En ce qui concerne les cursus non-scientifiques, il est extrêmement difficile d’avoir des données complètes sur le sujet. A ce jour, aucune statistique sur le taux d’employabilité n’est accessible sur le M2 DAST4, bien que la plaquette 2024 donne quelques exemples sur le type d’emploi accessibles après la formation. Sur le réseau social LinkedIn, on peut voir que les anciens élèves se tournent vers les grandes entreprises du secteur (notammentEutelsat, Safran et Thalès), mais également le CNES ou l’ESA. Une bonne partie des étudiants rejoignent un cabinet d’avocat après avoir passé les certifications nécessaires, en particulier pour du conseil dans le droit international5.
Les limites et les problèmes mis en évidence
La surreprésentation des “sciences dures”
On peut s’apercevoir que presque un tiers des formations proposées sont des Grandes Écoles d’Ingénieur: l’École Polytechnique et l’ISAE Supaéro sont les plus convoitées, mais également celles dont l’accès est le plus difficile. Le grand nombre de formations proposées, dont une bonne partie est publique, arrive néanmoins à offrir une alternative à ces établissements d’excellence, permettant à un plus grand nombre d’étudiants l’accès à des Grandes Écoles d’Ingénieur.
Les universités représentent également une bonne voie d’accès à l’industrie spatiale, avec une approche plus tournée vers la recherche et le développement. Elles offrent l’avantage de baigner dans un environnement plus varié, où les formations se rencontrent et se mélangent depuis des siècles, et sont incontestablement moins onéreuses.
Enfin, 35 IUT – Instituts Universitaires de Technologie viennent compléter le cadre des formations aux sciences “dures” avec un accès direct à l’industrie spatiale. Au total, 72 instituts sur 94 sont des institutions à caractère scientifique, technologique, mathématique ou d’ingénierie (les formations “STEM”): il n’y a que 22 instituts de “sciences humaines” qui offrent une formation spécialisée dans le secteur spatial. Il s’agit principalement de cours sur l’environnement, la géographie et l’observation de la Terre, qui s’appuient donc sur les données des satellites artificiels en orbite.
Parmi ces instituts, l’Université de Toulouse Paul-Sabatier et l’Université de Lorraine proposent des cours en médecine aérospatiale (la première en collaboration avec le MEDES, le centre de médecine spatiale de l’ESA, la seconde plus axée sur la médecine aéronautique) aux détenteurs d’un doctorat en médecine (Bac+9)67.
L’Université Paris-Saclay, quant à elle, propose le seul Master spécialisé en droit de l’espace, le M2 “Droit des Activités Spatiales et des Télécommunications”. Dépendant de l’IDEST – Institut du Droit de l’Espace et des Télécommunications, il vise à former des experts en droit de l’espace extra-atmosphérique, droit aérien ainsi que du droit du numérique. Comme spécifié sur les plaquettes officielles, cette formation accueille 20 étudiants par an, dont une bonne partie venant d’établissements à l’étranger.
L’absence de propositions pour les DROM-COM
La seule formation proposée dans les territoires ultramarins est l’IUT de Kourou, qui se spécialise dans la formation de techniciens industriels et autres BUT – Bachelors Universitaires de Technologie. Fort de sa proximité avec le Centre Spatial Guyanais, il accueille chaque année plus de 700 étudiants8 au sein de ses formations, majoritairement des étudiants résidents en Guyane Française. Quant aux autres territoires d’outre-mer, aucune formation spécialisée dans le spatial n’est proposée: les ultramarins seront forcés de se déplacer en France métropolitaine pour lancer une carrière dans le domaine spatial.
Les axes d’amélioration proposés
Élargir les possibilités des étudiants en droit, sans renoncer aux diplômes d’excellence
Nous avons pu voir que la seule chance pour un étudiant en droit d’associer ses études au secteur du spatial est de passer par le Master “Droit des Activités Spatiales et du Numérique”, qui n’offre que 20 places par an. Bien qu’il s’agisse d’un choix académique (les formations sélectives existent dans tous les domaines), et qui semble porter de bons résultats aux étudiants qui en sortent (tous semblent avoir une bonne carrière, avec des entrées dans le monde du travail immédiatement après leur diplôme selon LinkedIn), ce système implique que de nombreux élèves sortant de licence, brillants mais non excellents, devront renoncer à leur passion faute de places disponibles. Si une augmentation des places dans ce master ne paraît pas une solution particulièrement pertinente au vu de la nature de la formation, il pourrait être plus efficace d’encourager les grandes facultés de droit à ouvrir des spécialisations à thème spatial en Master. Avoir un plus grand nombre de diplômés en droit spatial permettrait à la France d’augmenter son poids sur les décisions internationales, ne serait-ce qu’en augmentant le nombre de personnes qui s’intéressent et sont en mesure de discuter du sujet.
Exploiter les péculiarités des DROM-COM pour donner plus d’opportunités aux natifs
Les territoires d’outre-mer peuvent donner une grande valeur ajoutée au monde scientifique français: en effet, fort de leurs position géographique souvent éloignée des grandes sources de pollution lumineuses, ils pourraient voir naître des pôles d’enseignement astronomique et d’étude de l’univers, avec la collaboration des observatoires locaux (comme l’Observatoire de Makes, à La Réunion) afin de développer la culture spatiale et scientifique en accord avec les spécificités locales. Cela donnerait aussi à plus d’étudiants le choix de ne pas émigrer en France métropolitaine pour étudier les métiers du spatial, ou de le faire plus tard.
Conclusions
La France et l’Europe se sont données pour ambition de se faire une place sur le plan mondial dans l’exploitation et la colonisation de l’espace. Afin de préparer cet effort, il est indispensable d’introduire les sujets spatiaux dans les programmes académiques des formations en sciences humaines dès maintenant: de l’étude de la psychologie des astronautes aux implications philosophiques d’une colonisation de l’espace extra-atmosphérique, nous devons impérativement éviter un futur dans lequel les sciences “molles” seraient mal préparées à ces nouveaux enjeux, pourtant inévitables dans l’évolution de l’espèce humaine. Une rupture sociale entre ces deux domaines, pourtant complémentaires, caractérisée par une part comprenant les enjeux spatiaux et une part qui n’y est pas sensibilisée, n’aurait comme conséquence que de créer une génération divisée, moins efficace et plus méfiante. La création de parcours académiques dédiés au domaine spatial, toutes spécialités confondues, est à voir dans le cadre de l’évolution de la société: si la France veut se faire une place dans l’économie spatiale de demain, il faut qu’elle donne les moyens à la nouvelle génération de cultiver sa passion pour l’espace (une passion qui est bien présente dans les 18/24 ans, comme le montrent les sondages) sans renoncer à des études de haut niveau.
Sources
- ISSAT – Institut au Service du Spatial, de ses Applications et Technologies ↩︎
- Catalogue des formations spatiales – Recherche d’organismes ↩︎
- IPSA – Observatoire des métiers de l’air et de l’espace 2023 ↩︎
- IDEST – Master 2 Droit des activités spatiales et des télécommunications (non mis à jour depuis au moins 2019, se référer au site de l’UPS Paris-Saclay lorsque celui-ci aura été remis en ligne) ↩︎
- LinkedIn – M2 Droit des Activités Spatiales et des Télécommunications ↩︎
- Capacité de médecine Aérospatiale – Université Toulouse III – Paul Sabatier ↩︎
- Médecine aérospatiale | medecine.univ-lorraine.fr ↩︎
- Institut Universitaire de Technologie – IUT de Kourou — Université de Guyane ↩︎