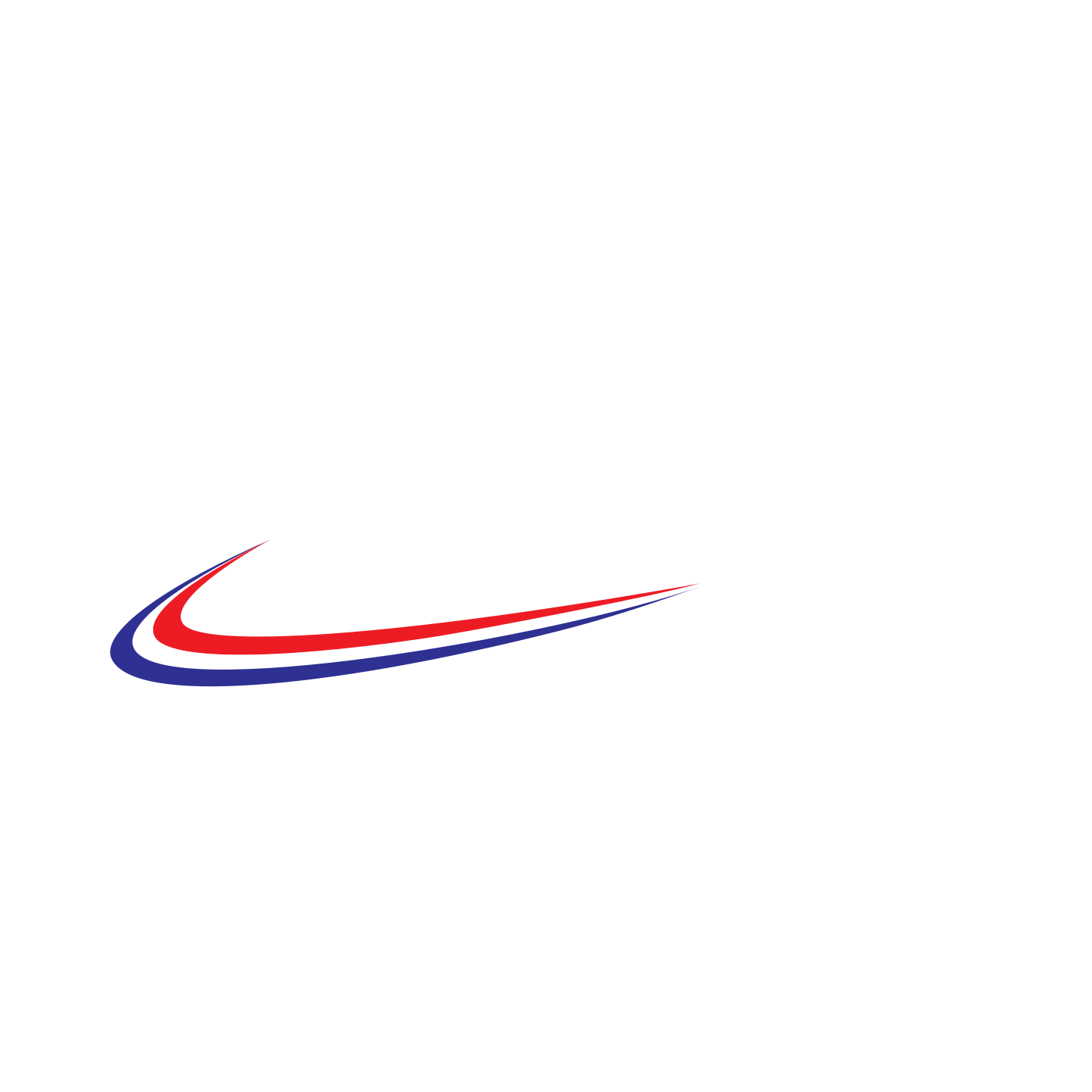Par Alix Guigné et Florent Delvert
La 13ème édition de Perspectives Spatiales 2025, organisée par le Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales et Novaspace, s’est tenue le 12 février 2025. Réunissant politiques, industriels, militaires et experts, cette journée a exploré la problématique centrale du futur de l’Europe spatiale face aux transformations géopolitiques et industrielles en cours. L’objectif de l’événement était d’analyser ces défis et d’esquisser des orientations stratégiques pour garantir le leadership européen et l’autonomie stratégique de la filière.
Dès le discours d’ouverture, le ton est donné : « le secteur spatial joue un rôle central dans la dynamique géopolitique contemporaine », rappelle le ministre de l’Enseignement Supérieur et ancien président du CNES Philippe Baptiste. L’arrivée de nouveaux acteurs privés aux côtés de décisions politiques outre-Atlantique a bouleversé la donne, créant à la fois des opportunités technologiques et des incertitudes stratégiques. Cette nouvelle configuration internationale oblige l’Europe à s’interroger sur l’avenir de ses coopérations, y compris avec les États-Unis, et sur les implications pour sa défense et ses partenariats économiques. Car parallèlement, l’espace est devenu omniprésent dans nos sociétés (communications, navigation, observation, etc.), mais cette expansion s’accompagne de nouvelles vulnérabilités. Selon P. Baptiste, l’industrie spatiale européenne fait face à un risque existentiel si elle ne s’adapte pas : elle doit engager une transition profonde, avec une vision à long terme, en veillant à ce que tous les acteurs avancent de concert. Cette nécessité se retrouve tout au long des discussions, où la fragmentation actuelle du secteur européen est régulièrement pointée du doigt comme un frein majeur en vue de la pression mise par les autres puissances spatiales.
Souveraineté et compétitivité : Un équilibre à trouver
La souveraineté spatiale a été soulignée comme un impératif non négociable. L’enjeu principal pour l’Europe est de préserver un accès souverain à l’espace, tout en s’imposant comme un acteur compétitif face aux géants que sont les États-Unis et la Chine. Ariane demeure à ce jour le seul vecteur garantissant un accès autonome de l’Europe à l’espace, là où « céder à la tentation » d’un lanceur étranger compromettrait définitivement cette indépendance. Dans le même esprit, « dépendre aveuglément » d’acteurs extra-européens ferait peser des risques critiques sur sa sécurité.
De son côté, le Commissaire européen Andrius Kubilius a averti de la fragilité de l’Europe spatiale en l’absence d’une stratégie industrielle cohérente, coordonnée et ambitieuse. Plusieurs intervenants ont d’ailleurs tiré la sonnette d’alarme : Hervé Derrey (PDG de Thales Alenia Space) a rappelé que dès 2024, Philippe Baptiste – alors président du CNES – soulignait déjà le retard pris par l’industrie spatiale européenne dans sa transformation. Un autre enjeu de taille est le décalage d’investissements avec les autres puissances, car l’Europe investit bien moins dans l’espace que les États-Unis ou la Chine – jusqu’à cinq fois moins selon H. Derrey.
Aujourd’hui, Ariane 6 est un jalon essentiel pour garantir notre souveraineté, pourtant certains redoutent que le modèle économique soit fragilisé sans un soutien institutionnel clair. Ces alertes posent une question essentielle : quels sont les besoins réels de l’Europe en matière de lanceurs dans les années à venir si ces Etats continuent de se tourner vers des acteurs étrangers ? Et plus largement, comment garantir son autonomie stratégique dans un environnement aussi concurrentiel ?
Cet écart grandissant met en péril sa compétitivité sur le long terme. Certes, le mouvement du New Space favorise l’innovation et l’agilité, mais il ne se limite pas aux startups. Il concerne également les grands groupes historiques, exigeant ainsi une vision commune et une coordination renforcée des grands programmes et des feuilles de route technologiques pour consolider la position européenne.
Les grandes orientations stratégiques pour l’Europe
Face à ces constats, les intervenants de Perspectives Spatiales 2025 ont esquissé plusieurs pistes d’action pour relever les défis identifiés. Un maître-mot a traversé de nombreux discours: coopération.
Josef Aschbacher, Directeur général de l’ESA, a dressé le bilan 2024 de l’agence et rappelé que les plus grands succès de l’Europe spatiale ont été bâtis sur la coopération entre nations. Le programme Ariane en est l’un des exemples emblématiques. Cette approche demeure plus que jamais d’actualité. Du côté français, Lionel Suchet (CNES) a souligné que l’espace est un outil diplomatique de premier plan et que la France participe à la quasi-totalité des missions aux côtés des grandes agences (NASA, JAXA, etc.), permettant de réaliser des projets qu’aucun pays ne pourrait mener seul. Toutefois, il met en garde contre les risques de dispersion intra-européenne : chaque nation considérant l’espace comme un levier de souveraineté et de croissance, une coordination étroite à tous les niveaux est nécessaire pour assurer une cohérence globale.
La coopétition – coopération entre acteurs européens tout en maintenant une compétition saine – a été présentée comme une voie incontournable pour renforcer le secteur spatial européen face aux nouveaux équilibres mondiaux. Cela implique une meilleure cohésion entre industriels, agences et États européens. La fragmentation actuelle doit être surmontée en faveur d’une approche plus intégrée. Une politique spatiale européenne harmonisée et la création d’un véritable marché intérieur spatial sont les premiers leviers à actionner pour donner aux industriels une visibilité accrue et une taille de marché suffisante.
L’élaboration d’une stratégie européenne de coopération internationale, validée par les États, permettrait d’élargir l’empreinte globale de l’ESA et de l’Europe. Pour y parvenir, il est crucial d’améliorer la collaboration avec les institutions de l’UE tout en prenant en compte la « renationalisation » progressive des politiques spatiales observée dans certains États membres. Plusieurs intervenants ont insisté sur la nécessité d’une clarification des rôles : une Commission européenne définissant une impulsion politique commune et une Agence spatiale européenne (ESA) recentrée sur l’exécution technique des programmes. La réforme du principe de “retour géographique” – qui répartit les activités au nom de l’équité entre pays – a été évoquée afin de privilégier la performance globale et l’émergence de champions industriels intégrés.
Assurer sa souveraineté et son indépendance technologique
L’idée d’inscrire dans la durée une préférence européenne dans les programmes institutionnels a émergé comme une réponse stratégique pour soutenir l’industrie continentale. L’exemple des lanceurs illustre bien cette orientation. Martin Sion (Président exécutif d’ArianeGroup) a réaffirmé le rôle crucial de la coopération européenne pour assurer l’indépendance du continent en matière d’accès à l’espace. Pour y parvenir, il est impératif de pérenniser un modèle économique viable, avec un volume de commandes suffisant et le soutien des institutions.
L’Europe doit également accélérer ses efforts pour rattraper son retard technologique face aux puissances concurrentes. En particulier, le développement des lanceurs réutilisables est un impératif pour garantir une compétitivité durable face à SpaceX et aux nouveaux acteurs du secteur. En parallèle, l’émergence de nouveaux segments technologiques, notamment en matière d’infrastructures orbitales, doit être anticipée pour ne pas être dépendant de puissances extérieures.
Au-delà des lanceurs, l’événement a mis en lumière plusieurs initiatives clés, comme le programme Iris², destiné aux communications sécurisées. Ce projet incarne un nouveau paradigme pour l’Europe spatiale et marque la volonté de l’UE de renforcer son autonomie stratégique. Catherine Kavvada, Director for Secure and Connected Space, Commission européenne, a rappelé que ce programme, développé en seulement neuf mois, repose sur une gouvernance innovante et une approche partenariale public-privé (PPP). Il représente une réponse directe à la montée en puissance des constellations concurrentes comme Starlink.
D’un montant de 10,6 milliards d’euros sur 12 ans, Iris² s’appuie sur trois piliers stratégiques : la souveraineté (infrastructure sécurisée et composants 100% européens, comme l’a souligné l’eurodéputé Christophe Grudler), l’innovation (intégration de la 5G, différenciant Iris² de constellations concurrentes comme Starlink) et la compétitivité industrielle de l’Europe. Assurer une mise en œuvre opérationnel rapide est crucial : il faudra industrialiser le projet sans tarder et fédérer une base d’utilisateurs (États, agences, entreprises) pour en garantir la viabilité économique. Iris² illustre ainsi une orientation clef discutée lors de l’événement : mobiliser l’UE sur des projets structurants, alliant autonomie stratégique et opportunités pour l’industrie.
L’enjeu immédiat est d’industrialiser ce programme sans tarder et de structurer une demande institutionnelle solide pour assurer sa viabilité économique et son rayonnement international. Iris² illustre ainsi une priorité stratégique pour l’UE : mobiliser les ressources européennes sur des projets structurants, alliant autonomie stratégique et compétitivité industrielle.
L’espace, une question de souveraineté mais aussi de sécurité
L’espace n’est plus seulement un outil civil, il devient un territoire stratégique militaire. Le Colonel Sylvain Debarre (NATO Space Centre of Excellence) rappelle que « L’OTAN considère désormais l’espace comme un domaine opérationnel à part entière ». Le domaine spatial étant intrinsèquement dual (civil et militaire), la question de l’avenir des programmes européens orientés défense est également posée comme centrale pour garantir l’autonomie stratégique du continent. Parallèlement, la dépendance grandissante aux services spatiaux pose la question de la résilience : nos infrastructures orbitales doivent pouvoir résister aux aléas (perturbations solaires, déchets en orbite) et aux nouvelles formes de conflits (cyberattaques, brouillages). L’enjeu climatique entre aussi en compte : les programmes d’observation de la Terre, comme Copernicus, jouent un rôle clé dans la sécurité civile et l’anticipation des crises, ce qui renforce l’importance stratégique de disposer de telles infrastructures en propre. Enfin, le contexte géopolitique tendu actuel exacerbe les enjeux de sécurité.
La guerre en Ukraine a illustré le rôle critique des actifs spatiaux sur le champ de bataille : satellites de télécommunication, d’observation et de positionnement ont été mis à contribution pour assurer les communications, le renseignement et la précision des frappes. Elle a également démontré que l’espace lui-même devient un théâtre potentiel d’opérations militaires, comme en témoignent les menaces posées par la cybersécurité.
Durabilité des activités spatiales
Pour Jean-Luc Maria (Exotrail), il existe six défis majeurs pour assurer la durabilité à long terme : mieux connaître et surveiller l’environnement spatial, mettre en place une réglementation internationale harmonisée (pour éviter le dumping réglementaire d’un pays à l’autre), adapter le cadre assurantiel, promouvoir la standardisation technique, développer les technologies d’intervention en orbite (désorbitage, maintenance…) et soutenir les petits acteurs innovants via des politiques publiques volontaristes. Ses pairs ont abondé en ce sens : l’entreprise Aldoria a chiffré l’ampleur de la pollution spatiale et confirmé le potentiel économique des services de surveillance et de gestion du trafic spatial à venir. Isabelle Sourbès-Verger (CNRS) a quant à elle, souligné que si l’Europe peine à rivaliser en termes de part de marché dans le New space, elle peut en revanche aspirer à un rôle de leader réglementaire mondial sur ces questions de durabilité. Elle appelle à un modèle où l’Europe est moteur d’une utilisation responsable et durable de l’espace, évitant de subir un cadre dicté uniquement par d’autres puissances. Les intervenants s’accordent sur le fait que la réglementation ne doit pas brider l’essor d’un marché naissant (comme celui des services en orbite), mais qu’une coordination globale est indispensable pour éviter le chaos et préserver l’espace comme bien commun.
L’élaboration d’un “Space Act” européen a fait consensus comme étant un facteur structurant pour l’avenir, mais questionne sur ces implications dans la compétitivité du secteur. Les industriels se questionnent, à terme, la démarche permettrait réellement d’optimiser les investissements publics et privés à l’échelle européenne et de doter l’Europe d’un cadre compétitif face aux géants internationaux ? À l’image du modèle américain, une législation spatiale européenne est présentée comme pouvant consolider un marché intérieur unifié, harmonisant les règles pour tous les acteurs et évitant les distorsions de concurrence entre pays. Romain Lucken a plaidé pour l’adoption d’une réglementation européenne assortie d’un véritable mécanisme de marché commun s’appliquant uniformément, tout en veillant à mettre à jour en temps réel le droit français (Loi sur les Opérations Spatiales – LOS) pour accompagner l’essor des nouvelles activités en orbite.
En matière de financements, il est apparu que le soutien public demeurera un catalyseur indispensable. La Banque Européenne d’Investissement dispose d’une enveloppe de 8 milliards d’euros dédiée à la sécurité et défense (dont 1 milliard spécifiquement pour le spatial). La banque intervient via des fonds (comme le Fonds Européen d’Investissement) pour soutenir des projets générateurs de revenus – par exemple le développement des nouvelles infrastructures de lancement par ArianeGroup. Ce type de financement, complété par les plans nationaux (tel France 2030) vise à déverrouiller l’investissement privé et à accompagner la montée en puissance des acteurs émergeants. Plusieurs dirigeants de PME innovantes ont souligné le rôle critique de ces soutiens publics. ThrustMe a démontré qu’en sept ans son entreprise avait pu s’imposer à l’international avec une production en série optimisée et une chaîne d’approvisionnement locale, preuve qu’on peut être souverain et compétitif simultanément. Mais elle avertit du risque de monopole dans les lancements et prône la diversification des options (petits lanceurs, lanceurs étrangers si nécessaire) pour garantir l’accès à l’espace en toutes circonstances. Elle insiste également sur l’importance des financements publics français et européens qui ont soutenu son innovation. De même, Sodern a partagé une recette du succès à l’export : investir continuellement en R&D, compter sur des actionnaires engagés et garder une vision à long terme. Grâce à cette stratégie, l’entreprise réalise 70% de son chiffre d’affaires à l’international tout en restant un fournisseur critique pour les grands programmes européens, illustrant la possibilité de conjuguer marché domestique souverain et rayonnement export. L’ensemble de la chaîne de fournisseurs spatiaux française génère d’ailleurs 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires annuel, dont la majeure partie à l’export, grâce à une adaptation constante aux standards européens et à des partenariats stratégiques mondiaux.
En somme, l’Europe doit trouver les bons outils pour favoriser le bon équilibre entre affirmation de son autonomie via des programmes moteurs structurant pour la filière en coopération avec les autres puissances spatiales pour partager les coûts, les risques et les bénéfices de l’exploration et de l’utilisation de l’espace. Le Commissaire européen Andrius Kubilius, chargé de la Défense et de l’Espace, a ainsi délivré un message ambitieux depuis Bruxelles : selon lui, l’Europe doit « prendre sa place » dans la nouvelle économie spatiale qui émerge et l’industrie Française aura un rôle moteur. Les idées et recommandations formulées tout au long de la journée tracent une feuille de route stimulante pour les années à venir. L’Europe spatiale a des défis à relever, mais aussi tous les atouts en main pour y parvenir : une longue tradition de coopération, des réussites techniques incontestables, et surtout une volonté partagée de préparer le futur et de faire de l’espace un moteur de progrès et de fierté pour les citoyens européens.