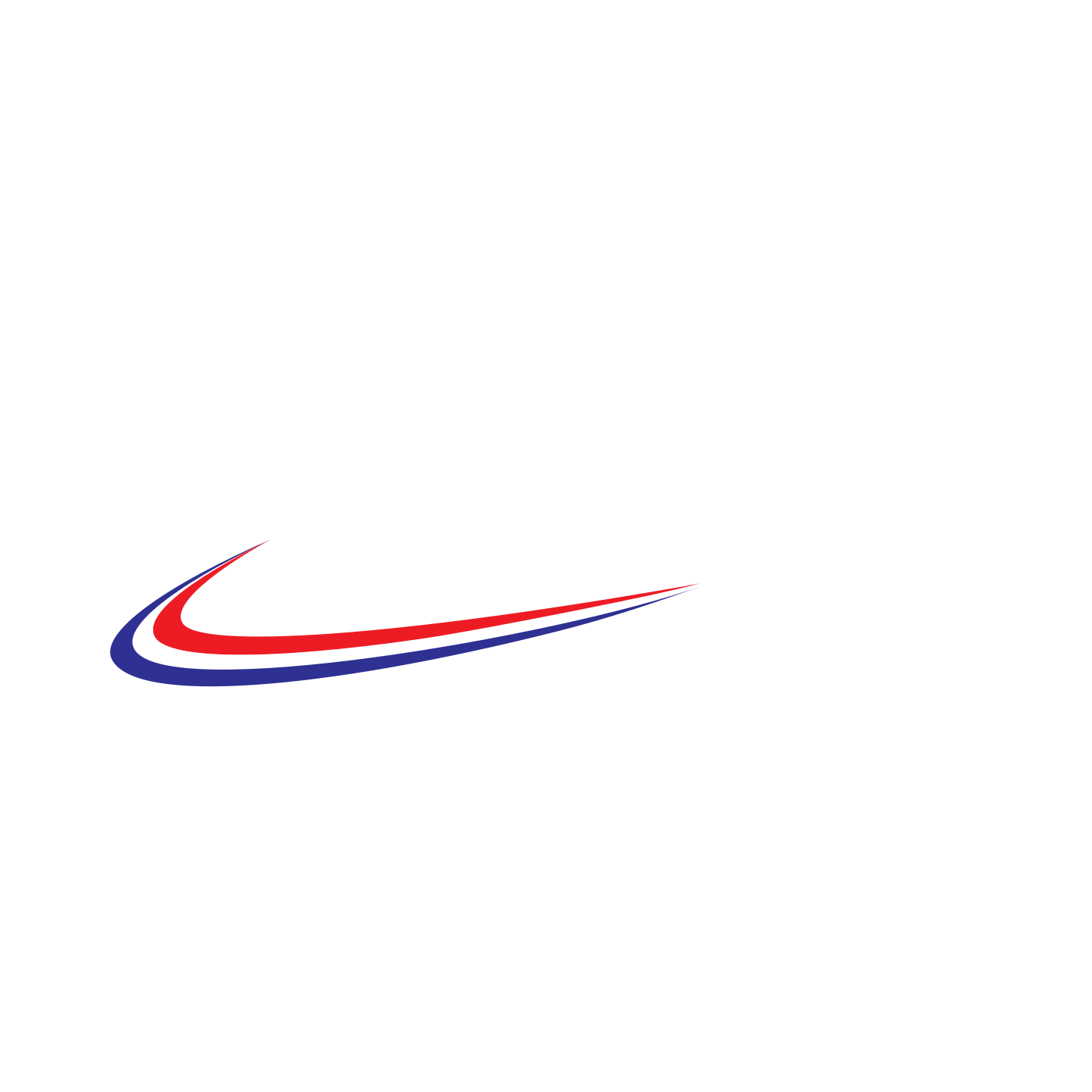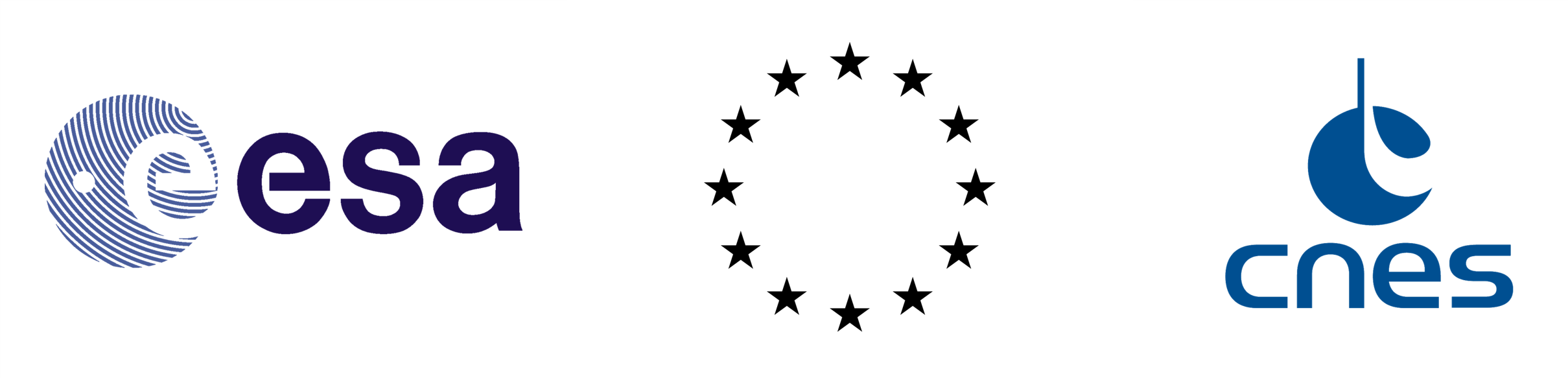Dans quel contexte évolue la France en matière de spatial ? A quels défis sommes nous confronté ? Les GT vous proposent leurs notes de synthèse pour mieux comprendre le paysage spatial actuel.
Par le GT Gouvernance
La politique spatiale française est largement associée à la politique spatiale européenne qui repose sur la coopération entre plusieurs 3 entités majeures : le CNES (Centre National d’Études Spatiales), l’ESA (Agence Spatiale Européenne) et l’Union Européenne (avec l’EUSPA, agence pour le programme spatial de l’UE).

Le CNES est en charge de l’implémentation et d’une partie de la conception de la politique spatiale française. Le CNES contribue aussi activement à la politique spatiale européenne en tant qu’agence nationale la plus importante de l’UE et de l’ESA. Ses missions incluent :
- Planification et exécution des programmes nationaux : développement de satellites, lanceurs comme Ariane (en collaboration avec l’ESA), et projets scientifiques nationaux. Exclusivité sur les programmes sécuritaires.
- Innovation technologique : développement de technologies spatiales, notamment dans l’observation de la Terre, les télécommunications et la navigation.
- Collaboration internationale :
- Avec l’ESA : participation à des programmes européens et intermédiation entre la France et l’ESA pour défendre les priorités françaises ;
- Avec des agences mondiales : partenariats bilatéraux avec la NASA, l’ISRO, CNSA, … (fin des partenariats avec Roscosmos depuis 2022)

L’ESA est l’agence spatiale européenne regroupant 22 États membres (dont certains non-membres de l’UE). Elle constitue le principal acteur européen pour les programmes spatiaux multilatéraux. Elle peut aussi implémenter les programmes spatiaux nationaux des États membres ne possédant pas d’agence nationale.
- Mission et financement :
- L’ESA est financée par ses États membres et par l’UE, sur la base de contributions volontaires et obligatoires.
- Ses priorités incluent la science spatiale, les vols habités, les lanceurs, l’observation de la Terre, la navigation et les télécommunications.
- Compétences principales :
- Développement de grands programmes européens : lanceurs Ariane et Vega, et missions européennes comme Rosetta et Gaia, …
- Gestion des infrastructures spatiales européennes : centres d’opérations spatiales, CSG, …
- Recherche scientifique et R&D : Centre technologique de l’ESA à Noordwijk
- Relation avec l’UE :
- L’ESA collabore avec l’UE pour exécuter des programmes phares comme Galileo (système de navigation) ou Copernicus (observation de la Terre).

L’UE est impliquée dans la politique spatiale depuis les années 2000, avec l’article 189 du TFUE qui officialise la politique spatiale comme une compétence partagée. L’agence pour le programme spatial de l’UE (EUSPA) est chargée de l’implémentation de ses programmes.
- Objectifs politiques :
- Assurer l’autonomie stratégique de l’Europe dans l’espace.
- Renforcer l’innovation, la compétitivité industrielle et la durabilité.
- Soutenir les priorités sociétales : sécurité, environnement, économie numérique.
- Programmes majeurs :
- Galileo : le système de positionnement par satellites européen, concurrent du GPS.
- Copernicus : programme d’observation de la Terre pour surveiller l’environnement et gérer les crises.
- Espace sécurisé : initiatives pour la surveillance spatiale (SSA) et la défense spatiale.
- Télécoms : GOVSATCOM, IRIS²
- Relations institutionnelles :
- L’UE travaille avec l’ESA via des accords de partenariat : elle finance en partie les missions de l’ESA pour les programmes spécifiques.
- Elle agit également comme un acteur politique en définissant les grandes priorités stratégiques (EU Space Law incoming…)